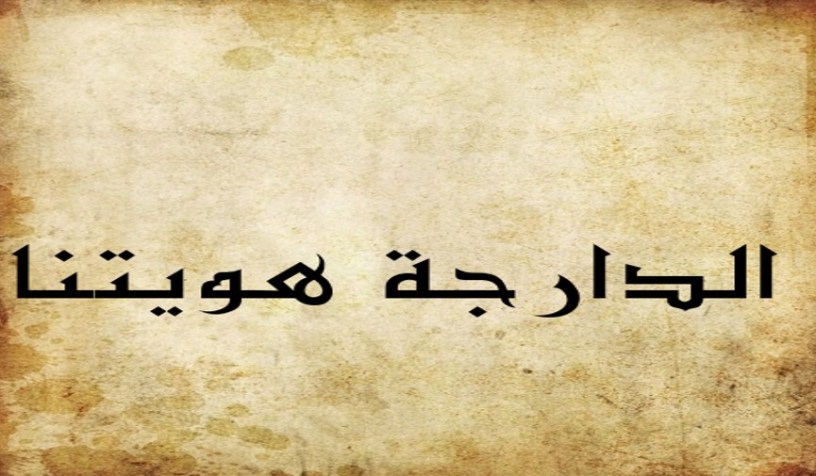L'ethnicisation forcée et lapidaire de l'identité algérienne, grave retour vers les identifications claniques, tribales et régionalistes ferment d'une dissolution de la construction d'une identité nationale vient de prendre une nouvelle force entre arabistes et berbéristes. L'identité algérienne a demandé cent trente ans de sacrifices et de souffrances "hallucinantes" selon l'expression de Frantz Fanon et occupé près de trente cinq ans les avant-gardes algériennes à construire le mouvement politique capable de porter cette identité. Berbéristes arabistes s'appuient sur des approches carrément mystificatrices pour les berbéristes et carrément mythiques pour les arabistes. Il faut rapprocher la démarche de ces derniers à la thèse de F. Fanon selon laquelle, face aux mythes coloniaux de négation d'une histoire des peuples colonisés, les colonisés produisent un contre-mythe national. Berbéristes et arabistes se nourrissent mutuellement et obscurcissent consentement la conscience algérienne en en faisant une fausse conscience qu'elle que soit le parti que l'on prend.
La publication du livre de Abdou Elimam vient apporter des éléments historiques posés sur des preuves archéologiques, linguistiques en plus des éléments historiques déjà connus tels que les pactes et les traités entre Carthage et les Igelliden (rois) numides.
Je publierai ce livre par fragments, chapitre après chapitre. Mohamed Bouhamidi
LANGUES ET ALGÉRIANITÉ (APRÈS 60 ANS D’INDÉPENDANCE) par Abdou Elimam
PRÉFACE
PROPOS LIMINAIRES
- La langue punique et nous
Lorsque l’on rencontre l’expression “langue punique”, on se fait rarement une idée précise de ce que cela renferme. Tout au plus, nous y reconnaissons une langue ancienne détachée de notre culture. Etant donné que cette langue sera souvent mentionnée dans cet ouvrage, j’ai pensé qu’il serait préférable de vous en faire une rapide présentation. De la sorte, elle ne sera plus une abstraction coupée du réel, mais bien une entité palpable.
En réalité cette langue qui vient de la Phénicie antique prend racine au Maghreb 9 à 8 siècles avant notre ère. Intégrant des caractéristiques locales, elle devient la langue de la grande civilisation Carthaginoise (et non pas de la Phénicie). Ceci la conforte pour des siècles dans la société maghrébine, puisque des témoignages dignes de foi (Saint Augustin, par exemple) confirment sa vivacité deux siècles avant le début de l’islamisation de notre région. On peut dire de manière fort assurée que la langue majoritaire à ce moment-là était bien la langue punique. C’est la langue des ancêtres des Maghrébins – à côté de variantes berbères bel et bien attestées, mais non hégémoniques. C’est ce que bien des historiens ont omis de préciser; et cela aura été bien dommageable. Voyons donc comment parlaient nos ancêtres. Je ne prendrai qu’ une petite liste de mots et une phrase pour nous en faire une idée précise – pour des raisons pratiques je n’utiliserai pas l’alphabet punique (que presque personne ne connaît), j’utiliserai une transcription en caractères arabes – pour faire l’unanimité.
Commençons par une série de mots de la vie courante, ceux que nos ancêtres devaient utiliser quasi quotidiennement:
Père (أب) – Mère ( ام) – fils ( بن) – fille ( بنت) – frère (حا ي) – soeur ( احت) – humain ( إدام) – femme (اشت)- homme (اش)- enfant (يلد) – descendance (بنيم) – petit-fils (بنبن) – proche famille (عم) -personne (نفس) – orphelin (يتم);
– bras/main (يد) -coeur (لب) – langue (لسن) -dos (صهر) – tête (ر اش) -vêtement (كسي);-
– eau (مم) -huile (شمن )- graine (زرع) – sang (دم) – lait (حلب) – oignon (بصل)- boucher (طبح) – bétail (بقر) – tigre (نمر) ;
– terre (ارص) – soleil (شمش) – jour/journée (يم) – lieu (مقم) – lever du soleil (مساء )- nuit (لل) – maison (بت) – pierre (صر) – mur (جدار );
-roi (ملك) – serviteur (عبد)- – courtier (سرسر) – artisan (حرش) – bien/bon (منح)- sacrifice (ذبح) – paix (شلم) .
A ces échantillons lexicaux, il faut mentionner la survivance de bien mots grammaticaux ( ب – مع- عل- etc.), de verbes, de prépositions de lieu, de temps, de manière et bien d’autres matériaux propres à une langue. Nous retrouverons plus loin cette même langue à partir de textes attestés. On mesurera mieux l’ampleur de l’héritage linguistique punique dans notre langue de communication majoritaire au Maghreb, le maghribi.
Observons, maintenant cette dédicace gravée sur une pierre tombale:
ذي مصبط بالشمر و الأمن ا شته اش طنا لهم بنهم عز بعل لعلم
De nos jours, dans l’est algérien ou en Tunisie, nous aurions l’équivalent suivant:
هذا ظرح بالشمر و الأمينا ستيه (الست انتاعه) اللي طلعلهم بنيهم عز بعل للعلم
Dédicace que nous pourrions traduire ainsi:
Ceci est la tombe de Belaachmar et de Amina son épouse que leur fils leur a érigée pour l’éternité.
Mettons-nous, maintenant, dans la peau de ces arabophones qui viennent au Maghreb pour essaimer l’islam. Ils rencontrent les habitants du Maghreb du VII/VIIIè siècle, les écoutent parler usant de tous ces mots que nous venons de parcourir. Ne croyez-vous pas qu’ils aient pu se comprendre mutuellement? Bien nombreux sont les chercheurs du monde entier qui le pensent.
- Ce que l’on entend par “langue” et “langage”
Cet ouvrage traite d’un sujet que tout le monde semble connaître tant il s’agit d’un don naturel. En effet, pour la science du langage, on entend par “langage” cette capacité des humains à mettre en mots nos pensées. Il s’agit là d’un don de la nature que tout membre de notre espèce possède – qu’il/elle soit du Maghreb, de Russie ou de Chine. Ce don est logé dans notre cerveau et il s’active chaque fois que l’on veut transmettre, par la parole, une intention. Par conséquent, il nous est impossible d’accéder directement au langage car il est entièrement intégré aux mécanismes du cerveau. En somme, le langage doit être considéré comme le cœur, le foi ou tout autre organe. Autre chose est la matérialisation (sonore) de la mise en mots ou parole. Dans ce cas, nous avons affaire à une émission sonore qui va mobiliser les cordes vocales d’un côté et l’ouïe, de l’autre. Il s’agit donc d’une réalité palpable. Et “la langue” dans tout ça, me direz-vous, à juste titre ? Et bien la parole pour être comprise utilise des moyens (mots, prononciation, expressions, etc.) qui sont conservés dans la culture. C’est ainsi que ces moyens circulent et sont partagés par tous ceux qui évoluent dans cette même culture. Une culture peut avoir une ou plusieurs langues (la culture suisse, par exemple, repose sur 4 langues). La linguistique a découvert que ces moyens (ce que de Saussure a appelé les “signes”) constituent un système cohérent qui s’inscrit dans la connaissance spontanée des enfants natifs; c’est cela une langue. C’est ainsi que ces dernières sont acquises dès le jeune âge.
- Ce que l’on entend par “langue maternelle”
Par “langue maternelle” ou “langue native”, on entend la forme initiale que le cerveau imprime à la parole de l’enfant. Cette forme a ceci de particulier qu’elle s’indexe à des opérations mentales, c’est pourquoi sa systématicité est naturelle. Toute autre langue qui viendrait à être apprise prend nécessairement appui sur les réseaux de neurones déjà balisés par la langue native. Vouloir exclure/censurer la langue maternelle revient à obstruer des modules vitaux de l’appareil cognitif de notre espèce. Dans un tel cas de figure, le réflexe de survie fait que l’on s’accroche aux compétences de notre mémoire non sans appauvrir le potentiel cognitif, malgré tout.
VUE D’ENSEMBLE
Dans son édification en tant qu’État moderne, démocratique et populaire, l’Algérie a intégré sans critique quelques mythes que le temps dévoile comme freins; voire comme des menaces à sa cohésion ethnique et linguistique. Ces mythes ont pour origine des lectures libres de l’histoire antique, plus particulièrement. Ces différentes représentations de notre passé sont source d’incompréhensions et d’inconciliabilité. Il est vrai que notre connaissance de l’histoire antique nous a été forgée à la fois par des auteurs latins, puis arabes – dont Ibn Khaldûn -, d’une part et par les ethnologues / historiens du colonialisme français, de l’autre. Les uns comme les autres ne se sont pas embarrassés des grosses lacunes et/ou arrangements avec la vérité, mais notre jeune État a été plus enclin à préserver une unité qu’à vérifier ces sources. C’est ainsi que des informateurs compatriotes – investis de cette tâche – ont pris le risque de fixer des postulats en dogmes. Or, leurs assertions sont mises à mal par une réalité socioculturelle qui nous rattrape et exige une réévaluation critique de telles synthèses. Il semble, en effet, que l’Histoire nous interpelle afin que nous assumions de manière transparente notre passé commun. C’est une condition sine qua non de garantir la sérénité nécessaire à notre évolution en tant que nation. Nous avons donc besoin de revisiter ce savoir quasi-officiel sur l’antiquité et le moyen-âge du Maghreb afin de laisser aux générations montantes un récit plus consensuel et vérifiable. Pour ce faire, il nous faudra nous diriger vers d’autres sources historiques pour recouper faits, moments, lieux et personnages. Ce travail, encore balbutiant, doit être engagé de toute urgence; dorénavant par des historiens compétents, spécialisés dans ces périodes et reconnus comme tels.
En effet, selon bien des travaux d’historiens non français, l’antiquité maghrébine témoigne de la présence de populations aux ethnies diverses se distinguant par une variété effective de langues et d’us et coutumes. Il est admis que selon l’histoire universelle, les communautés humaines se diversifient par leurs parlers ainsi que par leurs us et coutumes (ce n’est pas pour rien que le Coran – par ex. 49:13 – souligne cette particularité). D’ailleurs, nos croyances religieuses projettent le Paradis comme un domaine-espace où tout est unifié: langage, apparence et éternité. Nos réalités linguistiques et culturelles, ici bas, par contre, se caractérisent par la diversité. Par conséquent toute présentation d’un espace géographique de l’immensité du Maghreb comme un ensemble uniforme avec une langue, une ethnie et une culture ne peut relever que du mythe. Et ce type de mythe a des retombées contre-productives dans la société algérienne contemporaine. Outre la langue punique, on a retrouvé trace des langues hébraïque, perse, araméenne, syriaque, grecque en plus du libyque ainsi que des langues subsahariennes disparues, depuis. Les traces, notamment linguistiques, les plus proéminentes attestent de langues qui n’appartiennent pas à la famille afro-asiatique (le terme technique pour désigner les variantes berbères). Quant aux périodes où une souveraineté de tribus autochtones est attestée, il n’y a que celle du royaume numide avec Massinissa et ses héritiers; soit en tout et pour tout 146 ans (ce qui ne représente que 5% d’un temps historique de 3000 ans). A ce propos, un terme reste porteur de confusion: il y a le Royaume numide (autochtone), d’une part, et la Numidie (territoire sous souveraineté romaine) de l’autre. Avec l’islamisation du Maghreb, des tribus autochtones ont participé au pouvoir du califat arabe, cela est attesté, mais leur langue ainsi que leurs us et coutumes étaient bel et bien de culture arabo-islamique et maghrébines (parlant essentiellement en darija). La linguistique diachronique voit dans la reproduction des langues naturelles le signe d’une lignée historique bien lointaine. Par conséquent, les seuls échos tangibles de cette histoire multimillénaire du Maghreb, ce sont les langues qui se sont perpétuées: le punique qui évolue en darija ainsi que les variétés berbérophones propres à des régions ou tribus. Quant à tamazight, elle n’est langue maternelle de personne, elle est plutôt une pseudo-langue de laboratoire qui prétend coiffer et représenter les langues maternelles que l’histoire a su préserver jusqu’ici. Ce qui, à terme, représente une «bombe à retardement» légale … car légitimée par le texte de la Constitution.
Dans ce qui suit, nous relevons 07 mythes-refuges qui nécessitent des réévaluations critiques pouvant générer une délivrance psychologique, à laquelle la société aspire.
1. Notre histoire antique cadenassée par le prisme de l’idéologie
Il est établi que les «Berbères» ont été inventés essentiellement par les Arabes – Cf. notamment R. Rouighi, (Inventing the Berbers. History and Ideology in the Maghrib, 2019) et B.Michael & E. Fentress (The Berbers, 1996). Ce n’est qu’à partir du VIIIè siècle (et pas avant) que les Arabes désignent la population maghrébine de «berbère» – c’est plus particulièrement le cas de Ibn Khaldûn. Ils les ont appelés ainsi parce que leurs parlers étaient particuliers: une sorte d’arabe avec beaucoup de particularismes. Mais en même temps c’est grâce à la configuration linguistique à dominante punique de l’époque qu’un minimum d’intercompréhension a pu s’établir et que l’islamisation du Maghreb a bien réussi. Cette étiquette “berbère” s’estompe au fil du temps et il aura fallu attendre les ethnologues/historiens de la colonisation française, au XIX è siècle, pour voir cette catégorie émerger à nouveau et projetée sur l’antiquité (Y. Modéran: Les Maures et l’Afrique romaine (IVe-VIIe siècles), 2003). Ainsi avons-nous eu droit à une deuxième invention des Berbères et de la Berbérie, mais pour l’antiquité. Or, selon tous les historiens (y compris les français de la colonisation, d’ailleurs) rien ne permet d’attester quelque unicité ethnolinguistique du Maghreb.[1]
L’objectif stratégique des historiens de la colonisation française consistait à opérer puis à entretenir une distinction entre Occident (Rome, Byzance, Berbérie …), d’une part, et Orient (Carthage, Arabo- musulmans, Arabe …), de l’autre.
2. Notre pseudo-souche berbère en négation de la diversité ethnolinguistique naturelle
Le mythe d’une unité ethnolinguistique dite berbère avant l’arrivée de quiconque dans le nord de l’Afrique est pure projection. D’abord parce qu’un tel mythe s’oppose à la réalité universelle des communautés humaines et qu’il représente une sévère entorse à la logique de la vie sociale. Cela étant dit, on atteste bien de la présence de parlers reconnus par la linguistique comme étant génétiquement rattachés à la famille de langues afro-asiatiques (soit près de 350 langues parlées actuellement par environ 410 millions de personnes). Dans l’antiquité, la plus connue et établie était le libyque qui disposait même d’un système d’écriture dit «tifinaq» – clairement influencé par l’alphabet phénicien (article «t»+ racine F-N-Q [ت + ف ن ق ]). Cependant les populations vivant dans le nord de l’Afrique ne se limitaient pas aux berbérophones. Il y avait également des tribus ou regroupements de tribus parlant: hébreu, perse, syriaque, grec et bien d’autres langues subsahariennes dont on a perdu traces. Avec la civilisation carthaginoise, la langue punique s’impose comme langue consensuelle et prend ancrage chez une majorité de la population (Cf. témoignage de Saint Augustin et tous les historiens de l’antiquité maghrébine).
Réduire toute cette richesse humaine à une ethnie virtuelle et à une langue virtuelle a bien été le challenge de la colonisation. Ce challenge aura réussi à survivre au départ des colons et à inspirer ce mouvement dit «pan-amazighe» qui voudrait retrouver la situation de l’antiquité où seuls les Berbères auraient régné en maîtres absolus.
3. Notre arabité géopolitique indexée au fantasme de l’unicité linguistique
Dans la famille des langues dites sémitiques, on va retrouver le punique, l’araméen, l’hébreu, le syriaque, l’arabe et bien d’autres langues encore plus ou moins en usage de nos jours ou d’importance relative, à l’instar du maltais qui est langue officielle de l’Union Européenne. Toutes ces langues qui partagent un fond lexical commun et des traits grammaticaux effectifs sont proches les unes des autres. Et c’est une langue sémitique qui, dès le VIIIè. siècle av. J.C impose son hégémonie sans repousser les autres. Il s’agit de la langue punique, la langue de Carthage. Même le royaume numide en fait sa langue officielle et celle de sa monnaie. Cette langue est assertée au moins jusqu’au V è siècle Ap. J.C. A l’arrivée des diffuseurs de l’Islam, c’est l’intercompréhension possible entre le punique et l’arabe (plutôt qu’avec les variantes berbèrophones) qui favorise les contacts et la communication avec les autochtones. C’est aussi de ce contact que le punique retrouve une nouvelle vigueur – il est appelé “‘amiya” par les nouveaux occupants – et prend les contours de notre darija maghrébine. Par conséquent la langue arabe côtoie aussi bien les parlers berbères que la darija, dès le VIIIè siècle. Un bilinguisme heureux s’installe: l’arabe pour le fiqh, les hadiths et le nahw; les langues maternelles dont la darija, plus particulièrement, pour le reste des fonctions sociales et culturelles. Il n’y a donc pas eu d’arabisation, mais l’introduction d’une grande langue de civilisation aux côtés des langues naturelles locales. C’est à l’islamisation de la société qu’un tel bilinguisme (arabe+ darija / arabe + langues berbères) a le plus réussi. Nous sommes donc des Maghrébins islamisés qui ont inclus la langue de la civilisation arabo-musulmane à leur répertoire linguistique. Cette diversité linguistique a été source d’unité et de conquêtes qui ont marqué l’histoire. Rompre cette diversité par une arabité exclusive reviendrait à enrayer la dynamique unitaire que la diversité linguistique maghrébine a abrité, des siècles durant. Et qui a forgé notre identité.
4. Les berbérophones auraient perdu leur langue au contact de l’arabe
Les neurosciences contemporaines confirment que les humains naissent avec, dans leur cerveau, un dispositif dédié au langage. Ce dispositif – associé à la socialisation – génère, tout naturellement, l’acquisition de la langue maternelle. Les langues maternelles s’acquièrent donc sans apprentissage particulier, si ce n’est la (faible) contribution de l’imitation. Au contact d’une seconde langue, notre dispositif neurobiologique prend – naturellement – appui sur la langue de naissance parce que c’est cette dernière qui a inauguré le balisage neuronal d’accès au dispositif du langage. La mémoire, dans ce cas de figure, n’est qu’un accessoire. Il ressort de cela que l’arabisation exclusive des berbérophones est un challenge neurophysiologique de portée universelle puisqu’il contredit la thèse scientifique moderne sur les rapports en langage (cerveau) et langues (cultures). Leurs cerveaux auraient substitué à leur langue maternelle, une langue étrangère et à leur insu. On sait que ce point de vue, défendu notamment par W. Marçais («Comment l’Afrique du Nord a été arabisée», Annales de l’Institut d’Études orientales d’Alger, t. XIV, 1956, p. 6 – 17) et bien d’autres orientalistes (dont Camps Gabriel. «Comment la Berbérie est devenue le Maghreb arabe». In: Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, n°35, 1983. pp. 7-24) constitue la référence de très nombreux auteurs maghrébins. Outre le fait que cette thèse passe sous silence l’hégémonie politique byzantine (et non pas berbère) à l’arrivée des Arabes, elle contrevient à la nature humaine en matière de langage et de langues. En effet les Maghrébins berbérophones n’auraient pas pu se laisser «arabiser» au détriment de leur langue maternelle … car c’est cette dernière qui fraie le chemin neuronal à l’apprentissage d’une langue autre. Dans un tel cas de figure, on devient bilingue (berbère- arabe) et non pas «monolingue». Par ailleurs, et distinguant bien la darija (issue du punique) de l’arabe, comment se fait-il que la majorité de la population maghrébine soit devenue darijaphone plutôt que arabophone? Alors que la théorie colonialiste prétend que les habitants (berbérophones par axiome) sont censés avoir été arabisés, dans la réalité nous avons une majorité de darijaphones et une minorité de berbérophones. Quant aux arabophones de naissance, il n’y en a pas un seul – et ceci n’est pas le propre de l’Algérie. Pour comprendre ce qu’il s’est passé, il faut revenir à notre histoire antique pour retrouver deux langues-souches: le punique qui devient la darija (avec ses accents locaux); et le libyque qui se manifeste sous plusieurs variétés berbères.
5. Ce sont les Beni Hilal qui auraient détruit les restes d’une culture berbère
On attribue à l’invasion de tribus Hilaliennes l’arabisation ethnolinguistique d’envergure de l’Afrique du nord. Or ces tribus auraient mis plus de trois siècles (X- XIII è.) à parcourir leur long chemin du Hijaz au Maghreb, après un séjour consistant en Égypte. Nous allons faire l’économie des préjugés attribués à cette confédération de tribus pour ne nous intéresser qu’à la question linguistique. En effet, comment se fait-il que ces Hijazis parlaient en darija maghrébine plutôt que dans leur prétendue langue d’origine? Auraient-ils été «darijisés», à leur insu? Observons la nature (poétique) de leur langue à partir d’une de leurs quasidates parmi les plus citées, celle de Hayziya. En voici les premiers vers:
عزّوني يا ملاح في رايس البنات
سكنت تحت الحود ناري مڤديَي
يا خي أنا ضرير بيّ ما بيّ
ڤلبي سافر مع الضامر حيزييَ
Cette langue littéraire est celle qui a été développée au Maghreb à partir du VIII/IX ème siècle. Les mots, les expressions, la prononciation du «qaf» en «guèf» et bien d’autres caractéristiques indiquent que nous avons affaire non pas à de l’arabe du Hijaz, mais à la langue majoritaire des Maghrébins.
Cette remarque nous invite à faire l’effort de bien discriminer les deux langues dont la précieuse collaboration a facilité grandement la tâche d’islamisation du Maghreb: la darija et l’arabe (même si les deux langues appartiennent à la famille des langues sémitiques). Pourquoi donc ces «envahisseurs» qui auraient arabisé les populations du Maghreb parlent-ils une langue autre que l’arabe: celle, précisément, que les Maghrébin développent depuis le VIIIè. siècle?
6. La langue punique aurait disparu avec Carthage
Commençons par nous faire une idée de la façon dont parlaient les Maghrébins, 1000 ans avant l’émergence de la langue arabe. Dans le tableau qui suit, nous présentons, de droite à gauche, des échantillons (1) en écriture punique, (2) dans une transcription alphabétique arabe et (3) dans leur évolution en darija.
consensuelle du Maghreb (Réédition, Éditions F. Fanon, 2015) a mis au point un lexique de près de 500 entrées puniques collectées, à partir de corpus authentiques. Plus de 60% des mots (vocabulaire, verbes, adjectifs, prépositions, etc.) sont encore en usage de nos jours – cette pérennisation peut être constatée par tout le monde.
Notre ouvrage Le maghribi, alias ed-darija, langue
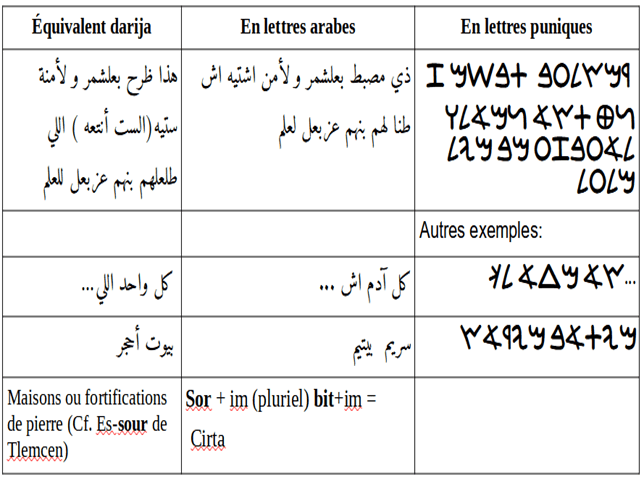
Jusqu’à l’arrivée des Arabes, le punique est la langue majoritaire des Maghrébins (y compris les princes/rois berbères l’avaient utilisée dans leur monnaie, par exemple). Et la transition du punique vers la darija se fait tout naturellement, à partir du VIII/IXe siècle. Nous en avons des traces écrites. Les opposants à la survie du punique sont précisément les défenseurs d’une idéologie prônant la suprématie de l’Occident sur l’Orient.
Nous sommes, aujourd’hui, les héritiers de cette histoire et nous devons préserver cet équilibre entre les deux langues: l’une pour le fiqh, la science et le lien avec le monde arabe; l’autre pour continuer de faire vivre la culture nationale et la singularité de notre algérianité. Cette dernière est une synthèse d’histoire qui nous a conduit jusqu’au 1er novembre 1954 et ensuite à la nation algérienne avec son drapeau et sa souveraineté mondialement reconnue.
7. Le ferment inconscient du «suprématisme» kabyle
Les jeunes (et moins jeunes) compatriotes ont été formatés par un récit de notre histoire antique et ancienne complètement façonné et biaisé. Ceci est colporté à la fois par les «anciens» (adeptes, malgré eux, de thèses occidentiphiles) et par les ambiguïtés «officielles» entretenues là-dessus. Une sorte d’évidence s’est incrustée dans nos références: nous aurions tous été berbères (ou amazighes) et nous aurions tous eu une langue unique, tamazight/berbère. Du coup on fait table rase de la réalité socio-culturelle des populations dans leur diversités ethniques et linguistiques pour imposer une vision purement idéologique. En résultat, les jeunes berbérophones (de Kabylie, plus particulièrement) ont le sentiment que les Arabes les ont colonisés et ont éteint leur langue mythique. C’est comme si les Byzantins, maîtres des lieux, en ce temps-là, n’avaient jamais existé.
Deux autres sources de frustrations sont à pointer. La première est de bien constater que l’amazighité ainsi que le statut officiel et national de la langue tamazight sont inscrits dans la Constitution, mais bien maigre semble être la traduction effective de ces acquis sur le terrain. La seconde est dans la nature même de tamazight qui, au lieu d’être une langue maternelle (donc un patrimoine national), est un artefact, une pure construction bureaucratique ressentie comme extérieure par les séniors ainsi que par les juniors de Kabylie. Le paradoxe est là: une «novlangue» fétiche – non parlée et sans profondeur anthropologique – que les adultes défendent bec et ongle, d’une part. Et d’autre part, l’impossibilité de faire admettre la langue chez les berbérophones de naissance. Le fait de demander sa généralisation et son obligation, non seulement tourne le dos à la démocratie linguistique, mais, de plus constitue une fuite en avant pour masquer l’échec d’une politique linguistique glottocidaire («tueuse de langues»), à terme, pour les langues maternelles berbérophones.
Déconstruire ces mythes, pour interroger l’histoire antique et médiévale, devient une urgence pour assurer un développement harmonieux et sain de notre jeune nation. De même qu’il nous incombe de réhabiliter la darija et sa littérature millénaire (adab ez-zajel, el-melhoun, etc.). Ce qui mettrait un terme à ces (honteuses) caricatures usant de calques franco-maghrébins hérités de la période coloniale. C’est ensemble que la langue du Coran et la nôtre parviendront à épanouir notre nouvelle génération. D’ailleurs, sur le fond, le désastre de l’éducation nationale n’a pas pour origine des moyens, mais la prise en compte de la langue maternelle de l’apprenant si on veut qu’il soit au «centre de l’enseignement», comme le préconisent tous les pédagogues du monde entier.
Cet ouvrage veut prendre date alors que 2022 est l’année de notre 60ème anniversaire de l’indépendance nationale. Voilà donc trois fois vingt ans que la darija attend son heure d’émancipation politique. Afin d’en faciliter la délivrance, nous avons réuni quelques-unes de nos récentes contributions dans la presse nationale, présentant les termes d’une plaidoirie sans complaisance en faveur du maghribi/darija. De leur prise en considération et du débat (souhaitable) qui en surgirait une politique linguistique profondément nationale pourrait se faire jour. Nous aurons alors comblé le maillon manquant à la plénitude de notre indépendance nationale.
[1] Le recours aux méthodes “scientifiques” de l’anthropobiologie désignent certes des populations effectives, mais les dotent d’étiquettes ethniques axiomatiques. Tel est le cas des populations maghrébines nommées “berbères”, de manière gratuite.
CHAPITRE 1.
La filiation punique du maghribi (darija)
Ce que la darija hérite de la langue punique[1]
C’est au début des années 1990 que j’ai eu l’occasion de découvrir la langue punique alors que j’étais dans un centre universitaire de recherche au Etats-Unis. Un article d’une revue spécialisée mentionnait une stèle récupérée d’un bateau coulé au large du Brésil et cette stèle était écrite en langue punique. La transcription phonétique que j’avais pu lire m’avait fait un effet magique. Je comprenais cette langue « morte » alors que je ne l’avais jamais rencontrée auparavant. Lorsque j’ai accédé à la traduction du texte, je me suis dit « mais c’est exactement ce que j’avais compris » ! J’étais sur les pas de ma langue maternelle mais je n’en étais encore pas totalement conscient.
De retour de ce voyage, je suis allé à Carthage et j’ai pu me plonger dans tout un ensemble d’inscriptions puniques traduites. Je découvre alors un lien évident entre ce qui se parlait à Carthage, il y a 2500 ans et ma langue maternelle. La darija ne vient donc pas de l’arabe… c’est une langue sémitique plus ancienne que l’arabe. Sa présence au Maghreb est probablement aussi ancienne que celle du berbère. Pour la faire découvrir, je me propose de présenter et commenter aux lecteurs quelques énoncés de cette langue appartenant à la branche sémitique et qui était parlée ici, près de 15 siècles avant l’arrivée des Arabes.
Pour éviter le système de transcription spécialisé des linguistes, je me propose de les écrire en caractères arabes afin que tout le monde puisse les déchiffrer. Notons, par ailleurs, que cette langue utilisait son propre alphabet, le phénicien, et s’écrivait (de droite à gauche). Rappelons, au passage, que cet alphabet phénicien a nourri de nombreux systèmes d’écriture de par le monde à commencer par les alphabets tifinagh, grec, hébreu, latin, araméen (ancêtre de l’arabe).
Examinons pour commencer l’exemple d’un énoncé simple. Nous le lirons d’abord dans un maghrébin moyen contemporain(1), puis dans la langue d’origine (2):
1. هذا ظرح بعلشامر و آمنه زوجته ألي طلعلهم بنيهم عزبعل للعلم
2. ذا مصبطت بعلشمر و لأمن اشت أش طن لم بنم عزبعل لعلم
Traduction : « Cette stèle est celle de Baalchamar et Amn son épouse, qu’a érigée pour eux leur fils Aazbaal pour l’éternité ».
On constate, avant tout, une différence de vocabulaire : [ظرح] = [مصبطت] (Stèle) ; [زوجته] = [اشت] (épouse+pronom) ; [طلع] = [طن] (élever, ériger). Mis à part le [ه] non réalisé (= *) dans [ṭalaεl*om bni*om] – chose qui pourrait s’apparenter à un « accent » régional –, l’énoncé devient quasiment recevable pour un maghribiphone contemporain.
Voyons, maintenant du texte suivi. Il s’agit d’un extrait d’une narration en punique, assertée (Poenulus présenté par M. Sznycer (1967)), où le narrateur décrit son entreprise en vue de récupérer sa fille ainsi que son neveu retenus en otage-grantie (nb. c’était une pratique courante). La traduction offerte par M. Sznycer est la suivante :
930 les dieux et déesses que j’invoque qui (sont) en lieu ci
931 que je mène ici mon entreprise à bonne fin, je le leur demande et qu’ils bénissent mon voyage
932 puisse-je reprendre ici mes filles, en même temps encore mon neveu
933 grâce à la protection des dieux et grâce à leur justice
Voici les quatre lignes dans leur transcription (effectuée par mes soins) en alphabet punique, puis en alphabet arabe, afin d’en faciliter le déchiffrage.
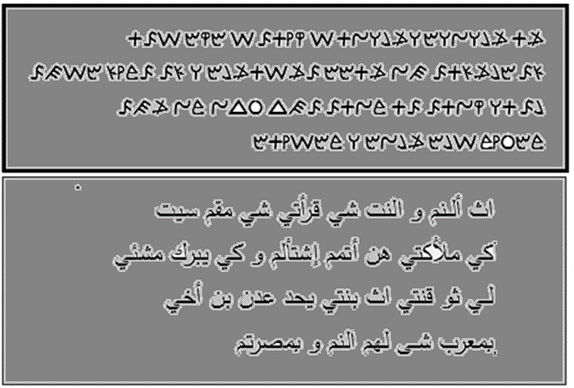
A première vue ce texte peut paraître bizarre, mais dès lors que l’on rentre dans le détail, la situation s’éclaircit lentement mais surement. En effet, nous avons 11 mots du lexique :
– 02/11 sont étrangers au fonds lexical (ألــنم et النت) ; noms de divinités;
– 01/11 a changé de signification (قــراء) – bien que le sens « d’évocation » ou « prière » est exactement celui que l’on retrouve dans (قرءان), soit « prières » en syriaque ;
– 02/11 mots existant dans le fonds lexical mais d’une utilisation rare ou précieuse (poésie) (معرب et مصر) signifiant, respectivement, « protection » et « justice » ;
– 06/11 mots qui ont conservé leur sens, même si leurs prononciations ont changé ( مقم – ملأك – مشئي (مشية)– قنت (قـانع)– بنت -بن أخي).
– Il y a 03/03 verbes qui sont encore en usage, même si leur forme a évolué :
(أتمم (يتمم) – إشتألم(نسآلهم) – يبرك)
Quant aux 09 mots grammaticaux (particules, adverbes, prépositions), il y en a :
– 06/09 qui n’ont pas ou peu bougé: و – هن (هنا/ هُني) – لــي – ثو ( ثَوَ/ دوكا) – يحد (واحد) – عدن (عادة/عوايد/وقت ) ;
– 03/09 qui ont changé de valeur ou ont disparu: شي (اللي) – سيت (هذا) – كي (باش).
Mises face à face, la version d’il y a 2500 ans et celle d’un maghribi moyen contemporain vont nous permettre une comparaison lucide :
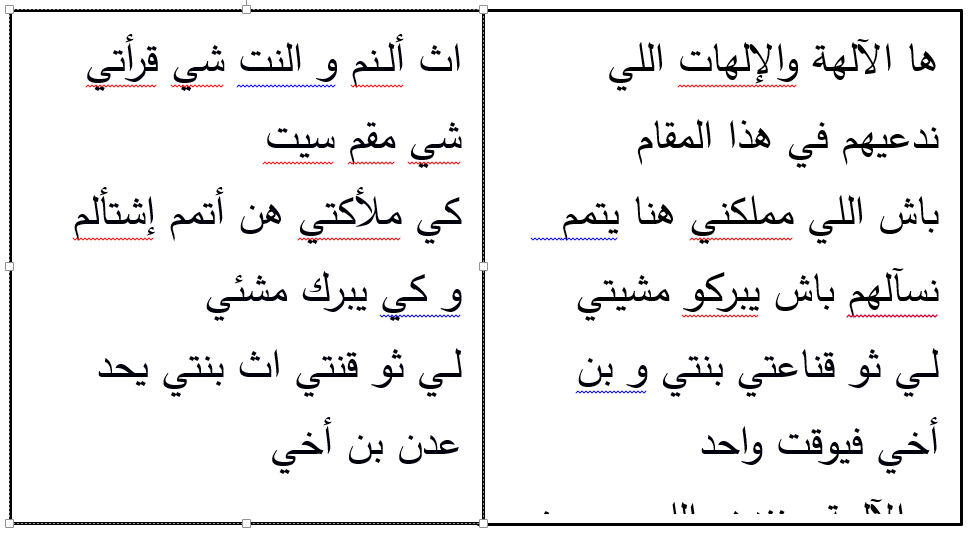
Pour récapituler, disons que subsistent 8/11 (mots du lexique) + 3/3 (verbes) + 6/9 (mots grammaticaux). Soit, au total, 17/23 ou 74% de la langue punique encore en usage – du moins pour ce texte.
Pour nous faire une idée de ces évolutions de la langue dans le temps, nous allons, dans un souci de comparaison brute, observer l’évolution de la langue française à partir d’un extrait des « Serments de Strasbourg », document qui remonte à 1200 ans (seulement) et qui symbolise la « naissance de la langue française »:
| En français du VIII e. siècle. | En français du XX e. siècle |
| « Si Lodhuvigs sagrament, que son fradre Karlo iurat, conservat, et Karlus meos sendra de suo part non lostanit, si io returnar non l’int pois : ne io ne neuls, cui eo returnar int pois, in nulla aiudha contra Lodhuvig nun li iv er. » | « Si Louis observe le serment qu’il jure à son frère Charles et que Charles, mon seigneur, de son côté, ne le maintient pas, si je ne puis l’en détourner, ni moi ni aucun de ceux que j’en pourrai détourner, nous ne lui serons d’aucune aide contre Louis. » |
Observons, maintenant, quelques mots utilisés par nos ancêtres, voici un petit échantillon (tiré au hasard de notre « Le maghribi alias ed-darija. Langue consensuelle du Maghreb – éditions Franz Fanon). Notons, tout de même, quelques évolutions telles que le « s » qui se prononçait « ch », ou le « t » qui pouvait se prononcer « d », le « kh » qui se prononçait « h », le « f » qui se prononçait « p », le pluriel se terminait en « im » au lieu de « in »:

On entend souvent dire : « tel mot vient de l’arabe », ce qui n’est pas faux, bien entendu, mais avons-nous seulement réfléchi au fait que ce sont souvent des mots qui se disaient ici plus de 1000 ans avant l’arrivée des Arabes ? De plus, un tel argument n’a aucune pertinence scientifique (ou historique) par contre il a la fâcheuse ambition de diviser, en réalité. Ce qui est visé, c’est de créer une scission entre la darija et l’arabe. Mais attention, ces deux langues cohabitent depuis près de 1000 ans, maintenant. C’est grâce à leur cohabitation que la société maghrébine a réussi à produire sa culture et sa langue consensuelle.
Par conséquent, si le libyque et le punique étaient là, préalablement à l’arrivée des Arabes, c’est bien la prédominance du punique – dont témoignent de nombreux auteurs à commencer par Saint Augustin- qui a facilité la pénétration de la langue arabe dans l’espace maghrébin. Mieux encore, elle lui sert de béquille, jusqu’à nos jours. Qui aurait donc intérêt à casser cette béquille ? A qui profiterait la mise à l’écart institutionnelle de la darija ? Je vous laisse deviner.
Du punique à la darija : les mots à l’épreuve du temps[2]
L’histoire antique du Maghreb témoigne de la forte présence de la langue punique, parallèlement aux poches berbérophones. Cette langue, héritée de la civilisation carthaginoise, était largement implantée jusqu’à devenir la langue officielle de la Numidie, par exemple. C’est dire la profondeur de son ancrage, toutes populations confondues. Mais c’est dire, également, que le mythe de la « langue unique » n’est qu’illusion car le Maghreb antique puis médiéval témoigne de la présence de plusieurs langues (punique, libyque, syriaque, grecque, latine, etc.). Seules les langues libyque et punique survivront aux différents occupants. Les variétés libyques nous parviennent en l’espèce de tamazight. Quant au punique, il se redéploie en tant qu’individualité linguistique à part entière, au contact de l’arabe, pour s’imposer en tant que darija, entre le VIII et le IX è siècles.
Pour bien comprendre la difficulté qu’ont eue certains chercheurs à restituer la langue punique, il faut rappeler que Rome a détruit Carthage avec l’intention de ne plus laisser de traces de sa civilisation. Tout a été brûlé et/ou enterré. Mais on ne peut enterrer une langue ! Bien qu’elle se soit maintenue à l’oral, la langue écrite (qui était disponible dans les pièces de monnaie, dans les stèles et autres supports de l’époque) se raréfie ou se transforme en un « néo-punique », écrit en caractères latins. La pratique de l’écrit, du temps de l’antiquité n’était réservée qu’à de rares occasions, souvent liées à la vie des dirigeants ou prêtres. Il faut bien garder en tête que les écrits ne circulaient pas comme de nos jours (livres, journaux, internet, etc.) ! Mais les chercheurs qui se sont spécialisés là-dessus ont pu, en comparant les langues, en utilisant des sources bilingues et des traductions anciennes (grecques ou latines) nous fournir des repères sur la grammaire et la syntaxe du punique. C’est en prenant appui sur ces travaux – reconnus par la communauté scientifique internationale – que je me propose d’exposer brièvement cette langue que nos ancêtres ont obligatoirement fréquentée.
Nous allons procéder en deux étapes. Dans un premier temps nous présenterons du vocabulaire courant avec quelques commentaires sur l’évolution (surtout phonétique) des mêmes mots. Nous introduirons, dans un second temps, des verbes et des prépositions afin de construire des phrases, sachant que la grammaire du punique s’est peu distanciée par rapport à celle de la darija.
Corps humain
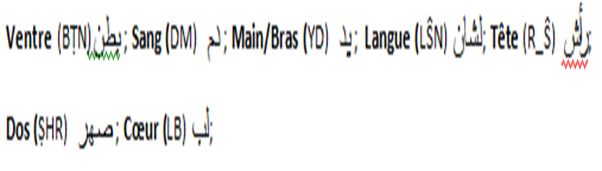
Remarques : Sur 07 mots : 03 n’ont pas bougé ; 02 ont troqué le « chin » pour le « sin » ; 01 a troqué le « sad » pour le « dhad » ; 01 qui a ajouté une lettre en initiale (« alif », ou bien « qaf /gaf». Tous les mots sont donc reconnaissables avec des variantes phonétiques que nous relevons, de nos jours, entre régions.
Relations/caractéristiques humaines

Remarques : Sur 12 mots : 07 n’ont pas ou peu bougé ; 01 a troqué le « chin » pour le « sin » et serait de nos jours مستبيت « mestabyet » ; 01 a troqué le « ya » pour le « wa » ; 01 a troqué le « pa » pour le « fa » ; ججع serait rendu de nos jours par جواع ; quant à متملل,
il serait une forme poétique de ملال. Tous les mots sont donc reconnaissables avec des variantes phonétiques que nous relevons, de nos jours, entre régions
Objets domestiques

Remarques : Sur 09 mots : 04 n’ont pas ou peu bougé
– إجان serait de nos jours, فنجال. Tissu donne “veste » ou « fista » ; « Tunique » et « tissu » ont été inversés en darija : « ksaa » et « Fista ». Donc 03 mots dont le sens a un peu changé. Il reste « mur » qui se disait « gadir » ; Cf. Agadir au Maroc, nom d’origine punique, donc. Notons que monnaie (ĜRT) rappelle notre « commercer » TĜR ; ce qui nous renseigne sur l’étymologie de ce verbe. Tous les mots sont donc reconnaissables avec des variantes phonétiques que nous relevons, de nos jours, entre régions
Il est clair que les lecteurs vont pouvoir, moyennant quelques variations phonétiques, vérifier la présence de ces mots dans leur vocabulaire contemporain. Les différences témoigneront de l’effet du temps sur les langues. On méditera, par exemple, sur le dicton populaire, « chahret lala ghir bnayeq » – le trousseau de madame est fait de bnayeq – où bniqa est une sorte de bonnet-écharpe qu’utilisent les dames à la sortie du bain. Ce mot nous vient de « BNQ » qui veut dire punique. En effet la racine punique « FNQ » a donné « BNQ » (ب – ن – ق > ف -ن – ق ) en Algérie. En somme la bniqa est la « petite punique », en écho à une tradition carthaginoise perpétuée par nos dames.
Après cette rapide présentation du vocabulaire (bien présent dans nos usages linguistiques contemporains), découvrons, maintenant, quelques verbes ainsi que le moyen de construire des phrases. Au bout du compte, nous aurons réuni suffisamment d’éléments pour nous faire une idée de ce que parlaient nos ancêtres et de la continuité de cette antique langue sous sa forme de maghribi, actuellement.
A l’instar de toutes les langues sémitiques, les survivances écrites du punique ne retiennent que les consonnes – c’est le cas de l’arabe, notamment. Nous avons donc des mots sous une forme consonantique que je me propose de transposer en lettres latines majuscules, entre parenthèses. Par exemple (ML’K) va donner en lettres arabes :. Cette racine sémitique peut produire « roi/reine », « fortune » et même « engagement/tâche/ mission », en punique. Ajoutons le mot (YIŠ) qui signifie « homme » et que nous allons rencontrer plus bas.
Ces précisions rappelées, poursuivons notre découverte de la langue de nos ancêtres.
Verbes d’action

Remarques : Sur 05 verbes d’action : 04 n’ont pas bougé ; 01 (TMM) est plus rare.
Verbes interpersonnels
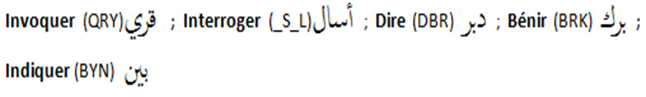
Remarques : Sur 05 verbes interpersonnels : 03 n’ont pas bougé ; 01 (QRY) a changé de sens puisque de nos jours il signifie « lire » – que l’on songe que le mot (QR_N) est un pluriel araméen de (QR_) et qui signifie « Les prières ». Le verbe (DBR) a changé de sens puisque de nos jours il signifie « débrouiller ».
En somme, 07/10 verbes sont toujours en usage et 03 sont maintenus avec de nouvelles significations.
Réunissons, maintenant quelques mots grammaticaux :
Où (_Y) أي ; Sous (TḤT) تحت ; Sur(3l) عل; Que/Quoi/Qui (_Ŝ) اش; A/pour/de (L) ل
Remarques : Sur 04 prépositions, 04 sont maintenues ; seul le pronom relatif a changé puisqu’il est « elli » de nos jours.
Essayons, à présent, de former des phrases avec les matériaux dont nous disposons – sachant que l’organisation de la phrase reste à peu près la même que celle que nous observons en maghribi. Nous allons tenter de fabriquer 07 phrases en punique, partant d’une phrase en français. Chaque phrase punique aura une traduction en maghribi contemporain (pas trop éloignée du texte punique, à dessein). Nous utilisons la graphie arabe pour restituer un minimum de phonétique sémitique et faciliter les rapprochements avec le maghribi (darija).
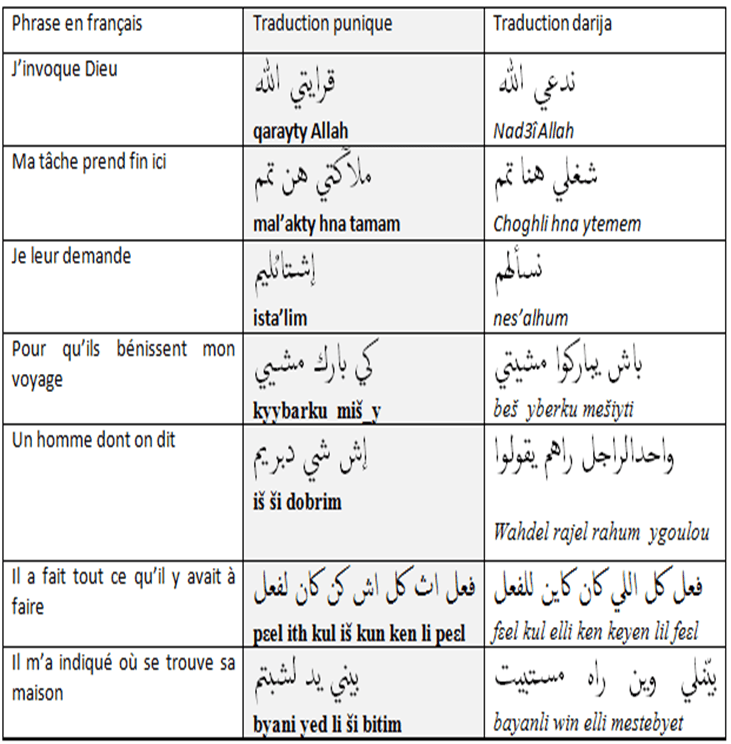
La construction de ces phrases nous révèle qu’elles constituent
La construction de ces phrases nous révèle qu’elles constituent des bouts d’un récit. Ce récit est tiré de M. Sznycer, Les passages puniques en transcription latines dans le Poenulus, 1967.
Forts de vos connaissances en punique, il vous sera possible, maintenant, de lire le texte original – tel qu’il a été rapporté par M. Sznycer. Il s’agit d’une fiction où un individu laisse sa fille et son neveu en otage le temps d’accomplir une mission puis revient récupérer les siens
Quelques précisions lexicales pour bien comprendre ce qui est écrit. Il y a les divinités auxquelles croyaient nos ancêtres qui étaient ( « alunim » et « alunut ») ; le verbe « QNTY » serait l’équivalent de qana3ti (« ma satisfaction »), en maghribi contemporain ; les mots « bnuty » (ma fille) et « ibn hy » (fils de mon frère) ; un mot grammatical : « yahed 3aden » (en maghribi contemporain « wa 3ed wahed » qui se traduit par « et en plus ».- Notons l’expression « bayani yed » = m’a indiqué de sa main.
Pour avoir une idée du poids des ans sur les langues, observons un extrait de la Chanson de Roland en ancien français et sa traduction en français contemporain (un peu plus de 1000 ans):
| Français moderne | Ancien français |
| Roland s’en va. Il parcourt seul le champ de bataille | Rollanz s’en turnet, par le camp vait tut suls |
| Lui-même sent que la mort lui est proche | Co sent Rollanz que la morz li est près |
| Les puys sont hauts, hauts sont les arbres | Halt sunt li pui e mult halt li arbre |
Observons, à présent des extraits de Poenulus (près de 2500 ans): en caractères arabes pour la phonétique, ensuite en caractère latins ainsi que la traduction suggérés par Sznycer.

Au terme de cette découverte, les lecteurs auront suffisamment de matériel pour se faire une idée précise de ce que parlaient nos ancêtres – en dehors du berbère, bien entendu -. En se réconciliant avec l’histoire des langues de ce pays, on s’interrogera sur le sort de la darija qui continue d’être minorée par l’institution, malgré son aura effective et consensuelle. Elle était bel et bien présente avant l’arrivée des Arabes. De nos jours, elle est toujours présente, en accompagnement de la langue arabe ; pas en opposition à elle. L’une et l’autre ont dû construire un destin. Il est temps de réaliser que la darija (maghribi) n’est pas de l’arabe, mais une langue sémitique à part entière. Il est temps de se libérer des étiquettes du type « arabe dialectal », « arabe algérien », etc. Raison de plus pour l’appeler par un nom digne et représentatif de sa profondeur historique : le maghribi.
Il en est qui, ça et là, suggèrent que la présence punique n’est qu’une « hypothèse » (défendue par A. Elimam). Or nous venons de découvrir non pas une « hypothèse », mais des faits de langue bel et bien attestés et reconnus par la communauté scientifique internationale. Comment se détourner de faits aussi flagrants, témoignant d’une continuité linguistique entre le punique et le maghribi ? Cette continuité est nourrie par un vocabulaire massif qui a traversé le temps pour être encore disponible dans cette langue de millions de locuteurs. C’est en qualité de locuteurs natifs que nous avons reproduit cette langue car elle est une langue maternelle – tout comme c’est le cas des variétés amazighes. Elle fait partie de notre nature, même si elle emprunte ça et là ce qui lui fait défaut … en attendant que l’institution étatique algérienne s’engage à la protéger et à lui donner les moyens de son développement.
Notre multilinguisme nous vient de loin, assumons-le[3]
Le plurilinguisme, qui est une des caractéristiques de la modernité et des démocraties les plus avancées, est souvent perçu comme une anomalie ; voire un danger dans les sociétés qui aspirent à la modernité et à la démocratie. Dès lors, qu’est-ce qui transforme un « plus » en un « moins » aussitôt qu’une frontière a été franchie ?
Pour savoir de quoi nous parlons, commençons par expliciter les bases neurologiques et culturelles (à la fois) du rapport des langues au langage humain. Une fois ces repères scientifiques posés, il sera plus facile d’échanger et de réfléchir à nos situations.
Éclairages des sciences du langage
Les sciences humaines et sociales ainsi que les neurosciences cognitives contemporaines nous apprennent que les langues sont comme les êtres: elles naissent, vivent et meurent … avec leurs locuteurs. C’est donc toujours à partir du locuteur qu’une langue est atteinte – sinon où et comment pourrait-on l’appréhender ? Parce qu’elles sont des prolongements des communautés d’humains, les langues ne sont pas des entités possédant un libre arbitre ; leur autonomie n’est qu’illusion fétichiste. Raison de plus pour signaler la vacuité des actes de « construction d’une langue » par des apprentis-sorciers de la nature humaine. Les langues de construction en laboratoire ne survivent – en tant que langues artificielles – que si elles constituent des codes formels comme ceux utilisés en programmation informatique ou en mathématiques, etc. Les langues naturelles sont partie prenante de l’espèce humaine et leur création reste tributaire de celle de notre espèce. Le propre des langues naturelles, c’est qu’elles entretiennent des rapports neuro-actifs avec leurs locuteurs natifs. C’est d’ailleurs cela qui explique pourquoi les enfants acquièrent la langue des adultes « spontanément ». Ce qui nous caractérise, nous humains, c’est la disposition neurologique et biologique de mettre en œuvre notre potentiel de langage : une machinerie logée dans le cerveau qui transforme des sons en images mentales et vice-versa. C’est d’ailleurs là l’objet essentiel de la linguistique – soit dit en passant, le reste est soit de la littérature, de la stylistique, de la grammaire, etc. Nous venons à la vie avec un dispositif biologique et génétique qui rend l’acquisition des langues naturelles tout à fait instinctive (un enfant d’Algériens qui grandit en Chine parlera chinois, spontanément, par exemple), dès lors qu’il y a socialisation. Et cette disposition reste accessible jusqu’à l’âge de la puberté (ce que les spécialistes appellent « l’âge critique » pour l’acquisition et l’apprentissage des langues naturelles) ; au-delà de cet âge, il faut bien de la persévérance et du travail personnel si l’on veut acquérir une seconde langue. Qui n’a tenté d’apprendre une langue étrangère sans se confronter à d’endémiques difficultés ? C’est ce qui fait dire aux véritables didacticiens des langues étrangères que la langue native (ou « maternelle ») est un passage obligatoire car c’est à partir de son quadrillage neuronal préalable qu’une seconde langue peut se frayer son chemin, puis s’installer. Effacer ou occulter totalement la langue native revient à empêcher l’apprentissage ou, tout au moins, le ralentir et l’amoindrir considérablement. En somme, pour apprendre une langue étrangère, il faut savoir prendre appui sur sa langue maternelle car sa préséance neuronale constitue une contrainte neurobiologique positive que seuls les didacticiens des langues les mieux formés savent gérer.
Maintenant que nous avons explicité notre arrière-plan conceptuel, abordons les questions linguistiques qui, au Maghreb, demeurent contournées sinon déplacées. Voyons cela.
La fragilité de la thèse de l’arabisation du Maghreb
Une des idées les plus ancrées dans l’Afrique du Nord contemporaine – y compris chez les universitaires – est que le Maghreb, anciennement berbérophone à 100 %, a été arabisé par les Musulmans dès le VII è siècle. Moins de deux siècles plus tard, la population est devenue arabophone et la langue berbère, une langue minoritaire. Ce scénario digne d’une fiction hollywoodienne relève du fantastique plutôt que de l’accommodation socioculturelle et linguistique plurielle du Maghreb. D’abord pour des raisons neurobiologiques.
Prétendre que des communautés entières de locuteurs natifs d’une langue A puissent « l’oublier » au profit d’une langue B est donc un argument dénué de tout fondement biologique et culturel. Dans le meilleur des cas, on devient bilingue. La neurobiologie a bien détecté une présence, à vie, de la langue maternelle dans le cerveau. Alors comment recevoir le message disant que la population nord-africaine a troqué sa langue (hypothétiquement unique et berbère, bien entendu) au profit de l’arabe ? En termes simples cela signifie que les locuteurs en question, nos ancêtres, ont oublié le berbère et se sont totalement identifiés à la langue d’occupation arabo-islamique. Et pourquoi cela n’a pas fonctionné ainsi avec le latin ou le grec, antérieurement. Sur un plan purement scientifique, un tel scénario est impossible. Qu’ils aient pu devenir bilingues, cela serait naturel, certes. Et – pour reprendre une remarque de mon ami Lakhdar Maougal – que dire des femmes, qui elles restaient entre elles, avec leurs tout-petits ? Comment expliquer que la langue allogène les ait atteintes au point d’oublier leur langue native. Cela ne saurait, non plus, se laisser admettre.
L’assertion selon laquelle les Arabes musulmans auraient arabisé le Maghreb, berbérophone par définition, relève donc bien plus d’un conte de fées que d’une réalité tangible et vérifiable. C’est à partir d’un tel récit affabulateur que nos représentations contemporaines se voient parasitées et qu’un sentiment de révolte peut effectivement s’en déduire.
Le punique, langue hégémonique du Maghreb antique
La véritable question est plutôt : pourquoi l’arabe aurait réussi là où toutes les langues des puissances occupantes ont échoué ? Si nous prenons en compte les réserves scientifiques mentionnées plus haut, la réponse serait : pas plus l’arabe que les autres langues n’y seraient parvenues !
La seule explication recevable et vérifiable (documents et traces archéologiques à l’appui) est que ces locuteurs avaient une langue maternelle si proche de l’arabe qu’un léger apprentissage/ accommodation permettait de l’utiliser et/ou de la comprendre. Il n’y a pas d’autres explications scientifiques. En somme, la langue des autochtones devait partager avec l’arabe un certain nombre de caractéristiques phonologiques, lexicales et syntaxiques. Ce phénomène n’est pas rare ; nous le retrouvons dans le groupe des langues chamito-sémitiques (quelque 350 langues dont : l‘égyptien ancien, le guèze, l’akkadien, le somalien, l’éthiopien, le libyque, le kabyle, le tachawit, etc.) ou bien dans le groupe des langues sémitiques (syriaque, hébreu, araméen, nabatéen, phénicien/punique, arabe, etc.), par exemple. Or il se trouve que des siècles durant, la langue hégémonique du Maghreb était une langue sémitique attestée : le punique !
Nous y voilà. La langue punique a été introduite par les phéniciens au début du dernier millénaire avant J.C. et son rayonnement s’est étendu sur tout le Maghreb, dès le VIIIè siècle av. J.C. Bien des langues se parlaient dans cette partie du monde et les tribus libycophones avaient effectivement perpétué leurs langues. Cela étant dit, la langue punique finit par s’imposer à tel point que même le royaume de Numidie l’adopte comme langue de souveraineté (notamment pour frapper monnaie). Ni Massinissa, ni ses successeurs n’en avaient été forcés. Les témoignages de la survivance de cette langue sont attestés jusqu’au Ve siècle J.C., au moins.
Culte de l’Occident dans l’écriture de l’histoire
C’est cela qui va déplaire aux défenseurs acharnés de l’Occident et l’une des tâches de ces anthropologues du colonat français (Cf. L’Algérie des anthropologues (1975) de J.C. Vatin et Ph. Lucas) consistera à minorer l’impact de cette langue, faisant ainsi écho aux Romains qui avaient détruit, brûlé et enfoui sous terre tout ce qui symbolisait la civilisation carthaginoise. Mis à part quelques auteurs courageux et intègres, les écritures de notre histoire ont phagocyté le fait punique pour le réduire à des « comptoirs colonisateurs». Tout cela pour nier une civilisation qui a mis Rome en échec pendant quelques siècles et dont l’étendue atteignait le sud de l’Europe. Ce récit à la gloire de l’Occident va devenir “la” référence historique. Leur récit consiste en l’élaboration d’une hypostase qu’ils nomment « Berbérie » et qu’ils dotent d’une peuplade unifiée tant par ses « traits ethniques remarquables » que par une langue unifiée, le berbère. En somme, le nord de l’Afrique serait berbère de lignée, de sang et de langue ; telle est la configuration du mythe en construction. Ils ne manqueront pas de renforcer leurs projections ethnolinguistiques en prenant appui sur les Grec (βάρβαροι «Barbares ») et les Romains (»Barbarus ») qui avaient, les premiers, ainsi désigné les populations nord africaines. Et ce terme « barbaroi/barbarus » que l’on pourrait traduire par « baragouin » visait précisément tous ceux dont le parler leur était intelligible ; qu’ils soient d’Afrique du nord ou bien d’autres contrées, d’ailleurs. Or un tel qualificatif des parlers de l’Afrique du nord antique signifie qu’ils étaient inconnus et incompréhensibles par les Grecs et Romains. Comment donc, les historiens- anthropologues de l’ère coloniale parviennent-ils à nous vendre que « la population était berbère et leur langue était le berbère » ? Comment peut-on désigner et nommer quelque chose que l’on méconnaît totalement ? Comment affirmer que la langue est X si on ne connaît pas X ? Dieu merci, ils n’ont pas francisé les termes grecs et romains, sinon, nous aurions eu droit à une population nommée « Baragouineurs » parlant le « baragouin »…
C’est ainsi que de telles visions ont pu s’ancrer suffisamment dans les représentations autochtones au point où nos compatriotes contemporains ne jurent que par cette version, même si elle manque lamentablement de documents et pièces archéologiques à son appui. La question à se poser serait plutôt, quels types de rapports les Puniques entretenaient-ils avec les autochtones ? La première série de réponses est issue du filtre posé par les anthropologues de la colonisation française. On voit bien que cette vision/écriture de l’histoire n’est ni sérieuse, ni constructive. Elle fait fonds sur un stigmate xénophobe qu’elle utilise comme arbre pour cacher la forêt : en effet la stratégie du colonat s’était évertuée, à tout prix, de discréditer l’Orient pour mieux magnifier l’Occident.
La vision arabe des populations maghrébines
Une deuxième source de réponses, qui obscurcira un peu plus la lecture historique des populations nord-africaines, viendra de la traduction du terme [بربر] tel qu’il apparaît sous la plume de savants arabes, à l’instar de Ibn Khaldûn, autour du XIV è. Siècle. Bien que s’affranchissant du contenu gréco-latin initial, en langue arabe, le terme désigne les tribus peuplant l’Afrique du nord. Les raisons linguistiques n’ont de toute évidence pas été convoquées pour opérer cette désignation. Le terme [بربر] désignait les autochtones ; tout simplement !
Le schème arabe BRBR constitue donc un homonyme (même sonorité mais sens différent) de « berbère » ; ce que les traducteurs ont négligé, produisant ainsi un « faux-amis », comme disent les traductologues. Un tel rappel vaut son pesant d’or. En effet pour les Arabes ce terme est synonyme du terme contemporain de « Maghrébin ». Dans toute la littérature andalouse, par exemple, ce terme est utilisé pour désigner les habitants du Maghreb. Ceci explique pourquoi la présence effective de « Berbères » en Andalousie ne se traduit pas par une présence linguistique libycophone. Bien entendu, les chercheurs qui se sont laissés aveugler par un préalable monolingue « berbère », ne comprennent pas ce phénomène. Une étude espagnole récente d’une chercheuse en langues du Maghreb se pose la question de savoir pourquoi il n’y a quasiment pas de traces de la langue berbère alors qu’ils ont participé à l’occupation de l’Espagne[4]. La réponse bien simple est que le terme renvoie, chez les Arabes de l’époque, à la population autochtone du Maghreb – qui, rappelons-le, était majoritairement punicophone à l’arrivée des Arabes.
C’est en remettant les choses dans leur ordre naturel que l’on pourra démêler ces zones d’ombre bien entretenues par des défenseurs opiniâtres de l’Occident (et ses valeurs). Surgiront alors des voies de réponses simples, naturelles et vérifiables.
Vers une clarification du passé linguistique du Maghreb
Les tumultes que nous rapporte l’actualité contemporaine autour d’exaltations identitaires sans fondements et surtout à visées de diversion, mériteraient une attention sage. En effet, les formes communautaristes et xénophobes des attaques visant la discrétisation de symboles nationaux sensibles sont, sinon ridicules, du moins révélatrices d’un malaise identitaire pesant. Or quelle qu’en soit la motivation première, ces manifestations de rejet de l’autre doivent pouvoir, tranquillement être prises en charge par le débat rationnel. Ce n’est que de la sorte qu’un minimum de critères consensuels peuvent émerger afin de favoriser des positionnements individuels ou collectifs réfléchis et argumentés.
C’est effectivement en convoquant la sagesse patriotique qu’il sera possible d’éclairer ces problématiques récurrentes. Mais pour permettre aux jeunes gens de mieux se positionner pour construire l’avenir qui est le leur, il faudrait sortir des sentiers battus et proposer des démarches transparentes et vérifiables par tous. Tout laisse à penser que l’Algérie contemporaine évolue dans un quiproquo historique – notamment sur la période antique- ; c’est ce quiproquo que l’on doit lever pour permettre à la nation de relever la tête et de débloquer la situation linguistique (et identitaire, par voie de conséquence). Lorsque nous finirons par accepter la pluralité linguistique de notre société et admettre la coprésence de ces langues avec des droits analogues, alors nous serons rentrés en modernité et nous aurons à défendre et préserver la démocratie linguistique.
Regards libérés sur les langues et le langage
La « lettre à M. le Président » que je viens de publier[6] m’a valu quelques retours d’amis plus ou moins proches me demandant de développer certains arguments qui s’y trouvent. Ces arguments, je les ai mobilisés pour conforter la nécessité de protéger institutionnellement la langue parlée et comprise par l’écrasante majorité de la population. Ces arguments abordent la langue darija (maghribi) à partir de son rapport au langage humain, son passé, son potentiel créatif ainsi que son rôle dans l’ancrage et la diffusion de l’Islam au Maghreb. Je dois admettre que le texte est un condensé d’idées déjà semées ça et là dans des articles de presse, dans des revues plus spécialisées ainsi que dans mes ouvrages.
Les feedbacks de ces amis me fournissent l’opportunité de pointer une situation de fait assez générale : en lisant, on passe trop vite sur des notions que l’on croyait connaître à l’avance. L’acte de lecture nous entraîne, à notre insu, à recourir à des filtres idéologiques ou dogmatiques qui nous réconfortent en retrouvant ce à quoi l’on croit. Dès lors que la pensée de l’auteur s’écarte de nos repères, on rejette ou bien on dépasse … à la recherche de connivences. Lorsqu’on en trouve, on considère que c’est un « bon papier », sinon, on le critique de manière expéditive. Je crois que c’est ce qui se passe avec des notions aussi «évidentes » que langage, langues, etc.
Par exemple, il est bien ancré dans la croyance populaire que « c’est dans les langues que s’exprime le langage (bon ou mauvais) ». Or le langage est une des fonctions du cerveau, indépendante des langues A, B ou C. Prenons l’exemple de la vision. Pour faire sens, l’objet perçu doit être analysé et identifié. Ce n’est qu’à ce prix que l’acte de voir atteint son objectif ; sinon la vision reste suspendue à cette décision sémantique. Par conséquent l’organe de la perception visuelle (les yeux) ne doit pas se confondre avec l’objet – avec ses formes, couleurs, volumes, etc. Pas plus que l’organe de la perception ne peut se confondre avec les fonctions de rétablissement du sens. Le parallèle avec l’activité de parole, c’est que la parole est faite de sons (produits par l’organe qu’est la voix ; ou perçus par l’organe qu’est l’ouïe). Ces sons présentent des lignes mélodiques différentes (selon la langue) mais lorsqu’ils parviennent au cerveau, ils sont soumis à une fonction cognitive spéciale qui s’appelle le langage. C’est à ce moment-là que le sens est fabriqué. La machine à fabriquer le sens est donc distincte des formes linguistiques qui lui font parvenir des messages. Et cette machine est «neurobiologique », nous dit la linguistique contemporaine. Dans ce cas, tous les humains, indépendamment de leur langue maternelle, disposent d’un même équipement dont les dote la Nature.
Que je parle kabyle, darija ou chinois, la fonction du cerveau dédiée au langage sera la même et peut être localisée (par IRM) dans les mêmes zones du cerveau. En somme, quelle que soit la forme du message, le travail non conscient de fabrication du sens repose sur une même machinerie biologique et neurologique. Certes, au bout du compte, le sens est marqué par la culture. Et ce dispositif de la nature fait actuellement consensus auprès des chercheurs en neurosciences contemporaines (biolinguistique, Intelligence artificielle, neurologie, psychologie, etc.).
Un tel argument est très rassurant car je n’ai plus aucune raison de me sentir démuni avec ma langue maternelle puisque c’est dans le cerveau que la fabrication du sens se fait. La preuve, c’est que mon propre cerveau d’Algérien est capable d’atteindre la compréhension de concepts ou de mécanismes abstraits de la connaissance universelle. La compréhension est bien indépendante des langues particulières.
Ceci nous ramène à la question de la valorisation des langues. Pour le langage humain, les langues ne sont que des fournisseurs de formes, de mélodies et de sonorités spécifiques qui, agencées par un sujet-locuteur, constituent un message. Le langage humain agit, alors, comme un décodeur (c’est le « démo » de l’humain, en quelque sorte). Cela veut dire que l’agencement des formes doit répondre à des protocoles ou codes que seul le langage humain est en mesure de « décoder » pour générer du sens. Ces codes constituent l’objet central de la science du langage (linguistique); ils sont en cours d’explicitations approfondies grâce aux neurosciences.
Y a-t-il des « bourses des valeurs linguistiques» ? Si les langues fournissent des formes reconnaissables par le cerveau en tant que porteuses de messages à décoder, la première de leurs caractéristiques est d’être en harmonie avec les cerveaux humains. Or, l’unique moyen d’établir un lien organique, biologique et neurologique entre une langue et les cerveaux de millions de locuteurs, c’est que cette langue soit captée et mise en circuiteries neuronales, dès la naissance. Le linguiste appelle cela une « langue native ». La « nativité » renvoie au travail biologique de synchronisation entre la forme extérieure et sa recevabilité au niveau du cerveau. Cette synchronisation se fait naturellement ; c’est ce que les psycholinguistes appellent « l’acquisition ». Tout le monde l’aura remarqué : les enfants reproduisent (par paliers) la langue des adultes en respectant les accords (masculin /féminin ; singulier /pluriel), les temps verbaux (présent/passé/futur), les modalités (possible/certain /éventuel) et bien d’autres nuances. Ils savent tout cela de manière non consciente. En définitive, c’est de cette manière que, naturellement, les langues de la naissance balisent les chemins d’accès à la connaissance. Ainsi a été conçue notre espèce.
Cette notion de langue native est à distinguer de la notion de « langue mère ». Lorsqu’elle est native, c’est de la naissance de la personne humaine qu’elle tire sa réalité ; lorsqu’elle est « mère », elle est génitrice et non pas générée. Il est vrai que l’on dit cela de langues telles que le latin ou l’arabe car elles sont supposées avoir généré des individualités linguistiques (le français, le portugais, le roumain, etc., d’un côté, et de l’autre, le syrien, l’égyptien, l’irakien, etc.). En réalité, nous avons affaire à une belle illusion d’optique car les langues ne se constituent pas par elles-mêmes, mais sont le produit d’une culture. Et la culture est, à son tour, le produit de l’activité humaine en société. Par conséquent les familles linguistiques puisent dans des fonds culturels bien circonscrits géographiquement. Les linguistes appellent cela des « aires linguistiques ». Il en est ainsi de l’aire sémitique qui regroupe toutes les langues (arabe, hébreu, syriaque, punique, maghribi, etc.) qui partagent des caractéristiques communes sans pour autant se substituer l’une à l’autre. Les langues chamito-sémitiques (tachelhit, kabyle, haoussa, le somali, langues éthiopiennes, etc.) qui représentent plus de 300 langues partagent des traits sans pour autant se dissoudre les unes dans les autres. C’est donc bien d’une aire linguistique donnée que les langues de cette famille vont s’inspirer. Quant aux langues qui se génèrent elles-mêmes, à l’écart des hommes, elles n’existent encore pas.
Pour nous résumer, disons qu’une langue est un creuset représentatif des apports de ses locuteurs. Il n’y a pas de «langues de la science » en soi. Il y a des hommes de science qui recourent à leur langue pour graver leurs connaissances. Moins on produit de connaissances que l’on enregistre par écrit dans sa langue, moins les générations futures trouveront de la matière pour leurs apprentissages. Il n’y a pas de langue pauvre, il n’y a que des hommes acculturés au point de se haïr et de vouloir tourner le dos à la langue qui les a fait êtres sociaux. Déprogrammons-nous, amis locuteurs. Il ne revient qu’à nous de laisser aux générations à venir une langue dont ils n’auront pas à rougir.
Mon grand-père, qui tenait ce dicton de son propre père, disait : « kayen elli klam emmu fi fumo, wa kayen elli yamchi 3and jaro iyjibo » ( كاين اللي كلام امه في فمه و كاين اللي يمشي عند جاره يجيبه – Il en est qui disposent de leur langue à fleur de bouche et il en est qui vont chez le voisin se la procurer).
La langue unique: un mythe déstructurant[7]
Aucune société humaine n’est pourvue d’une langue unique; parfois d’un quartier à un autre, bien des distinctions linguistiques se révèlent systémiques. D’un village à un autre, également, des spécificités phonologiques et syntaxiques s’imposent à l’observateur. Ceci n’est pas un mystère pour la linguistique. C’est ce qui a conduit bien des chercheurs (à l’initiative du linguiste polonais, B. de Courtenay), dès le XIX e. siècle à constater que bien des parlers appartenant à une aire géographique donnée partagent des traits linguistiques manifestes (lexique, phonologie, morphologie, etc.). Il en est ainsi, par exemple de l’aire linguistique romane, certes, mais on peut retrouver ce phénomène partout dans le monde (aires germanique, anglo-saxonne, slave, éthiopienne, etc.). La diversité des parlers est un des témoignages de la spécificité de notre espèce à tel point qu’il n’est pas hasardeux de dire que le monolinguisme ne peut être qu’une vue de l’esprit. Pourtant … me diriez-vous, on parle bien de la langue française ou de la langue anglaise ou de la langue arabe, en tant qu’entités singulières et identifiables. Ce serait donc paradoxal.
Voyons cela de plus près.
La nature a fait de notre espèce des êtres de langage; c’est-à-dire des êtres dont le dispositif biologique et neurologique de naissance comporte une prédisposition de communication par la parole (en plus des gestes, mimiques, etc.). Nous naissons avec le potentiel de langage. En d’autres termes, nous arrivons au monde avec un appareillage biologique qui nous permet de réagir, porté par la parole, à l’environnement social. Ce réflexe ou « instinct de langage », comme l’appelle le psycholinguiste S. Pinker, se met en mouvement dès nos premières heures de socialisation. La nature nous dote donc d’un dispositif inné de réaction au monde via l’expression verbale, comme l’avait démontré, en son temps, l’anthropologue A. Leroy-Gourhan. Dit autrement, le langage ne s’enseigne pas! Pas plus que la digestion ou la vision (comme le souligne N. Chomsky). C’est une mécanique spontanée qui se met en place parallèlement à d’autres caractéristiques propres à notre espèce: la position debout, la marche, l’indication des objets par l’index, etc. L’instinct de parole – dont les mécanismes ont pour siège le cerveau – agit comme un moule qui accueille le parler environnant (celui des parents) et le traite en interne. Ce que l’état de la science contemporaine permet de dire, c’est que de manière récurrente, des zones spécialisées du cerveau (en d’autres termes, le langage) s’activent lors du traitement de la parole. C’est donc un mécanisme inaccessible et non conscient qui établit un lien entre cette parole traitée et sa signification. Là encore, nous avons affaire à des mécanismes dits cognitifs, qui échappent à notre maîtrise mais qui permettent de générer, à partir du traitement de la parole, une réaction faite de sens (ce que l’on appelle également une « image mentale »). C’est de la sorte que notre espèce accède à la langue des adultes – sans apprentissage. On pourrait même dire que la langue maternelle est un cadeau que Dame Nature fait à l’être social que nous sommes.
Les langues maternelles sont à la fois « naturelles » et sociales. Naturelles parce que leur acquisition est une œuvre systématique liée au développement des humains. Sociales car le réflexe langagier n’émerge que dans une monde partagé par d’autres êtres eux-mêmes munis des mêmes dispositions naturelles de langage. C’est ainsi que les langues naturelles se reproduisent et parviennent à traverser le temps sans trop de changements formels. Certains linguistes en sont venus à parler de la faculté qu’ont les enfants de « réinventer la langue des adultes »!
La parole première s’inscrit donc dans les traits de la langue de l’environnement immédiat. Mais le monde est ainsi fait que d’autres formes de langues (naturelles) existent dans un voisinage géographique immédiat. Lorsque j’étais enfant, ma langue maternelle avait les traits de la variante tlemcenienne du maghribi, mais dès que j’eus des contacts directs avec les enfants du quartier, qui eux parlaient la variante oranaise, j’ai dû m’accoutumer et retrouver, spontanément, les « équivalences » – essentiellement phonologiques, d’ailleurs. On devient « bilingue » sans le savoir, en quelque sorte. Il en est ainsi pour tout le monde: les variations linguistiques constituent des entités en contact dont l’accommodation inconsciente minimise les différences au profit des ressemblances. C’est de cette disposition que dans nos représentations, nous ne percevons qu’une seule et même langue. La langue déclarée commune est une œuvre de représentation et non pas une réalité tangible (la description des parlers rendrait compte, obligatoirement, de différences). A cet arrière-plan neurobiologique et social, viennent se greffer d’autres déterminations sociologiques et culturelles qui insufflent de la « distinction sociale » (pour reprendre le sociologue P. Bourdieu) aux variantes linguistiques. L’identification aux classes sociales va contribuer de manière décisive à minorer certains parlers et sublimer d’autres (Cf. « el_Hdar » vs. « el_3roubi »). C’est bien par un effet idéologique (et non pas ontologique) que la représentation linguistique qui fait consensus dans une société donnée s’impose de manière hégémonique. C’est ce qui s’est passé en France où le parler de Versailles (du temps de la royauté), le francien, est devenu la langue de référence. Or le francien est une langue naturelle qui se reproduit par la naissance – à l’instar de toutes les langues naturelles et maternelles. C’est pourquoi le francien réussit là où le latin s’était avéré impuissant. En effet, le latin n’a jamais réussi à devenir une langue native ou maternelle; il s’opposait avec dédain aux « latins vulgaires » parlés par les populations locales. Or ce sont ces parlers « vulgaires » qui, de nos jours, sont devenus les langues nationales de France, d’Italie, d’Espagne, etc. C’est leur caractéristique de « langue naturelle et native » qui leur a conféré cette disposition naturelle d’être reproduite par la naissance et de se pérenniser à travers le temps. Pendant ce temps-là, le latin est rangé dans la catégorie des « langues mortes ».
Qu’en est-il de l’aire dite « arabophone » ?
Il se passe dans cette aire sémitique exactement ce qui s’est passé ailleurs: les langues naturelles se sont reproduites par la naissance et se sont pérennisées à l’instar du libyque et du punique que nous appelons de nos jours, berbère et maghribi (ou darija). La langue arabe est une norme linguistique inspirée essentiellement du texte coranique; c’est d’ailleurs après la Révélation que le travail sur la normalisation linguistique arabe a commencé (‘3ilm el_3arabiya). C’est à l’ombre du Coran (lecture/récitation) que cette normalisation linguistique, mature vers le VIII e. – IX e. siècle, se pérennise en tant que langue franche de l’empire arabo-musulman. Cependant, en 14 siècles, la langue du Coran n’a jamais réussi à devenir la langue de naissance de quiconque! Au-delà de toute explication, ce qui est manifeste, c’est que cette langue a bien une apparence (ed-dhahir) de toute langue naturelle, mais elle ne réagit pas comme les langues naturelles. De toute évidence, elle ne partage pas les mêmes attributs profonds (el-batin) que les langues naturelles; ce sont précisément ces attributs qui contournent l’organe de langage et qui, par conséquent, inhibent la caractéristique de nativité. Notons que selon des savants Arabes du VIII-IX e. siècle (dont As-Souyouti, Ibnu-JIni, Ibnu En_Naqib et bien d’autres), le Coran contient plus de 20 langues différentes; quant à son son harmonie interne, elle relèverait de lois mystiques peu ou pas perceptibles. Par conséquent, si par ses aspects formels elle a pu servir de moyen de communication s’identifiant à la civilisation arabo-musulmane, elle n’est jamais devenue une langue native. En d’autres termes, la « politique d’arabisation » est mise en échec depuis 14 siècles … par la langue elle-même. Quand finirons-nous par en prendre conscience et réaliser une bonne fois pour toutes que la nature nous dote de dispositions pour la reproduction des langues natives mais pas pour celle d’une langue dont le génie de composition échappe totalement aux capacités humaines.
A ces arguments qui reposent à la fois sur les neurosciences contemporaines et sur l’histoire des langues, il faut ajouter cette information cruciale: la langue de la civilisation arabo-musulmane n’a pu réussir que parce qu’elle a toujours fonctionné en binôme avec les langues natives. C’est sur la base de ce bilinguisme de fait que l’arabe a réussi à devenir une langue franche. Or ce bilinguisme chez nous, il est fait de variantes berbères plus l’arabe, d’un côté, et du maghribi plus l’arabe de l’autre.
Après trois mille ans de développement linguistique du maghribi (sur la base du punique) et du berbère (sur la base du libyque) au Maghreb, il est clair que la culture produite est partagée par les trois langues (au sens de représentations consensuelles). Si la culture portée par l’arabe nous rattache au monde arabe, celle portée par les langues natives de la nation nous rattache à un imaginaire bien plus national et singulier. Parler de culture nationale n’aurait de sens que si l’on intègre, réellement, les artefacts produits dans nos langues du terroir. Or nous resterons bien loin du compte, tant que la langue consensuelle, le maghribi (darija), demeure recluse et mise en touche de l’institution.
Pour conclure, je dirais que le monolinguisme est ravageur pour une société multilingue comme la société maghrébine (ainsi que le souligne, de son côté, le linguiste A. Dourari). Les retombées se ressentent dans l’échec patent de la qualité d’enseignement, du mal-être social, de la baisse de production culturelle et dans la fuite en avant sous toutes les formes (depuis la harga jusqu’au déni de civisme).
[1] Paru dans le Soir d’Algérie du 27/09/2020
[2] Parus dans le Soir d’Algérie du 09/09/2020
[3] Parus dans Le Quotidien d’Oran du 24/06/2021
[4] « Le rôle du berbère dans le développement linguistique d’al-Andalus n’a cependant pas été analysé en profondeur. Cela est dû à la rareté des données concernant non seulement l’état des variétés berbères à l’époque, mais aussi leur impact sur l’arabe andalou et la rapidité de leur disparition de la scène linguistique de la péninsule ibérique. » Ángeles Vicente, Andalusi Arabic, in Lucas, Christopher & Stefano Manfredi (eds.). 2020. Arabic and contact-induced change. Berlin: Language Science Press. Pp.225-244.
[5] Paru dans le magazine en ligne Algerieculture.com le 07/09/2020
[6] Cf. Le Quotidien d’Oran du 31/08/2020
[7] Paru dans le Soir d’Algérie du 11/11/2020
CHAPITRE 2. Maghribi/darija et fuçħa : une dualité millénaire
Arabe et darija : 1000 ans de cohabitation[1]
De manière directe ou indirecte, les questions linguistiques travaillent la conscience et le vécu des Algériens (ainsi que celle des autres Maghrébins, d’ailleurs). C’est ainsi que les locuteurs natifs de ce pays se voient entraîner dans des identifications linguistiques parfois loufoques. Nous serions tous : Arabes ou plutôt Amazighs ou plutôt Méditerranéens, voire Africains ! On le voit, soixante années après l’indépendance, notre algérianité n’est toujours pas pleinement assumée. Ne plus jouer à l’autruche avec les questions identitaires nous permettra d’éviter de substituer des fantasmes à la réalité – avec toutes les retombées que cela implique.
Un proverbe bien de chez nous dit : « ma3za oulâ Târet » – (c’est une chèvre, même si elle vole). Ceci s’applique aisément au traitement que subit notre histoire. On aurait tous été «Berbères» avant d’être conquis par les « Arabo-musulmans » et là, nous troquons notre langue « unique » pour devenir, majoritairement, des locuteurs « arabophones ». Cette caricature – lourdement et profondément ancrée par le colonialisme, il faut le rappeler – reste, de nos jours, la « référence » spontanée à toute interrogation sur l’identité. Alors que la réalité de notre histoire et de la langue majoritaire (la darija) témoignent d’une narration, certes refoulée mais bien différente! Voyons cela de plus près.
Bien nombreux sont les travaux sur l’antiquité du Maghreb, de chercheurs sans lien avec la colonisation française, qui révèlent la présence d’une multitude de langues sur ce territoire. Mentionnons, en vrac : le punique, l’hébreu, le syriaque, le grec, le libyque, l’araméen et bien d’autres moins connues. Comment peut-on expliquer cela ? Simplement par le fait qu’à l’époque, l’idéologie linguistique chauvine (phénomène récent dans l’histoire) n’existait pas. On parlait, certes sa langue native, mais on recourait aux autres langues ou à leurs alphabets sans complexe. Les langues ne s’identifiaient nullement à un territoire politique.
Ce n’est qu’avec l’émergence des Empires (Mésopotamiens, Grecs puis Romains) que cette question linguistique change de nature tant la gestion de l’Empire commande le recours à une langue de référence – ne serait-ce que pour la reconnaissance des pièces de monnaie. C’est ainsi que les Grecs qui prospectent le nord de l’Afrique – plus de mille ans avant J.C. – y rencontrent une population qui « parlait de manière méconnaissable », c’est-à-dire autre chose que le grec. C’est pour décrire ce phénomène d’intercompréhension difficile qu’ils ont qualifié la population de « barbare» – adjectif qui en grec signifiait « au langage méconnaissable ». Or, nous l’avons mentionné plus haut, la population de ces contrées parlait plusieurs langues et non pas une seule– même si toute palabre méconnaissable avait été étiquetée, sans distinction, de « barbare ». Les Romains useront du même qualificatif que les Grecs pour désigner les langues méconnues d’eux, dont celles des Nord-Africains. Étaient dits « barbares » tous ceux dont la langue n’était pas le latin, en gros. De nos jours, le même qualificatif est en usage scientifique sous l’étiquette de « allophones » ; c’est un synonyme. Voilà donc l’origine du mot « berbère » qui est un appréciatif d’altérité et non pas un marqueur d’identification ethnique ou linguistique.
Le système colonial français a su s’agripper à ce qualificatif pour construire une fable historique mettant en scène une population mono-ethnique et monolingue : les Berbères. De là, ils leur ont projeté un espace géographique à forme variable : la Berbérie. Cette fable historique, dont l’essence aspire à tourner le dos à l’Orient au profit de l’Occident, fut une source inaltérable de discours distinguant/opposant « Arabes » à « Berbères » et inspirant de nombreux travaux légitimant une telle vision de notre histoire. Ils ont fait fi de la période Carthaginoise dont la langue, le punique, se répand sur tout l’actuel Maghreb – malgré la masse de traces archéologiques qui en témoignent. Ils ont fait fi de la nature plurielle des populations de cette contrée ainsi que des langues. Ils ont réussi à nous « vendre » un peuple « berbère» à la langue « amazighe » que les Arabe étouffent pour asseoir leur domination ; belle bombe à retardement.
Qui peut sérieusement croire à une telle fabulation ? Arrêtons-nous une minute pour scruter cela. Si la population était « totalement » berbérophone, comment aurait-elle pu communiquer avec les diffuseurs de l’islam de cette période entre les VIIe et Xe siècles ? Nos fabulateurs osent même des contradictions grossières : en intégrant l’Islam et ses textes, nos ancêtres à la fois mono-ethniques et monolingues auraient fini par oublier leur langue native (supposée unique) et se sont mis à parler, de manière majoritaire, non pas l’arabe classique importée tout récemment, mais la darija ! Les interférences linguistiques entre tamazight et le maghribi sont tellement minimes que l’argument que le darija est le produit du « berbère arabisé » est une vue de l’esprit. Disons, en passant, qu’ils attribuent aux Arabes un talent de didacticiens jamais égalé, dans toute l’histoire de l’humanité. Et oui, de nos jours, avec tout l’environnement adéquat (dictionnaires, internet, cours en présentiel, méthodes, immersions, audio-oral, multimédia, etc.), nous avons tous tellement de mal à utiliser proprement une langue étrangère ! De là à oublier la nôtre en faveur de celle apprise : c’est quasiment de la magie ! Soyons sérieux : on peut, certes, devenir bilingue (à la limite), mais on ne peut pas troquer sa langue de naissance, pour la raison suivante : c’est notre cerveau qui, à notre insu, construit la trame de langage sous forme de réseaux de neurones que rien ne peut effacer au profit d’une autre trame de langage. Cela est impossible chez les Humains – mais pas pour une machine. La trame de langage que notre cerveau imprime nous sert de tremplin à l’acquisition des connaissances ainsi que d’autres langues. Insistons bien là-dessus : sur la base de cette trame initiale et avec son concours.
Par conséquent, si les gens n’ont pas pu troquer leur langue native pour une autre langue native, c’est tout simplement parce qu’ils parlaient autre chose que tamazight. L’histoire nous apprend qu’ils parlaient, en vérité, une langue proche de l’arabe. Une langue qui était déjà là depuis plus de 1500 ans. Et cette langue, qui est l’ancêtre de la darija, c’est la langue punique. Voilà qui explique les facilités linguistiques de communication entre les habitants de ce nord de l’Afrique et les Musulmans venus d’Orient avec, comme mission, de faire admettre le message coranique. Depuis, la langue punique se métamorphose en «Luġat al-qawm » (comme l’appelle Ibn Faris (Xe siècle)) ; voire « el-3amiya ». Depuis lors, les destins des deux langues sont liés. Que deviennent les variantes berbères, me diriez-vous, à juste titre ? Elles ont toujours existé de manière dispersée en tant que langues natives, elles-mêmes en binôme fonctionnel avec la langue arabe. Elles n’ont, de toute évidence, pas pu être « une langue dominante » – le ratio qui existait entre la darija et le berbère semble, aujourd’hui, grosso-modo le même qu’à l’arrivée des Arabo-musulmans.
Par ailleurs, la fabulation attribuant aux Arabes une « invasion violente » contre les populations « berbères » locales est vite démentie par l’histoire réelle. Les Byzantins qui régnaient en maîtres, alors, avaient opposé la force contre les Arabes. Les tribus des autochtones, qu’elles furent berbérophones ou punicophones, étaient sous domination byzantine. A l’exception notoire de la Kahina qui vint – furtivement -renforcer l’offensive byzantine, les autres populations ont plutôt pactisé avec les promoteurs de l’Islam– tels sont les faits dominants.
Certes la darija (ou maghribi) et l’arabe se sont toujours secondées, complétées, remplacées – selon les situations de communication. Les fonctions religieuses et administratives ou scientifiques étaient remplies par l’arabe ; le reste (vie sociale et culturelle et vie intime), par le maghribi et le berbère (proportionnellement). C’est bien cette répartition des tâches – mise en place dès le départ, comme en témoignent de nombreux documents de la jurisprudence, notamment – qui a permis d’atteindre une sorte d’équilibre culturel. En effet, la culture locale est assurée par le maghribi pendant que la culture arabo-musulmane et universaliste l’est par l’arabe. C’est cela qui a fait la cohérence ainsi que la spécificité culturelle et linguistique du Maghreb : à la fois personnalité culturelle forte et distincte, et, membre du monde arabe. Cette trame de fond a subi ses premières secousses durant l’occupation Ottomane. Son renversement est consacré avec la colonisation française. En effet la mise en opposition des deux langues a commencé durant cette période – sans que l’on ne s’en aperçoive. Les indépendances des pays du Maghreb ont validé cet état de fait en privilégiant le pa’arabisme au détriment du national. La darija (maghribi) est dite langue « vulgaire » ou « dialectale » (en reprenant les catégorisations de la colonisation, d’ailleurs). L’arabe est portée seule au sommet de l’État. Cette séparation et l’opposition surfaite qui leur ont été imposées par une idéologie en manque d’assurance a produit ses effet en un demi siècle : l’Algérien se caractérise par sa « mal-vie », son envie endémique d’émigrer, son détachement civique alarmant, la détérioration de son langage au quotidien, un système éducatif d’exclusion culturelle dont l’improductivité est dramatiquement reconduite d’année en année, une production scientifique quasi inexistante sur le plan international, etc.
Séparer et opposer ces deux langues que l’histoire a faite «sœurs siamoises » revient à démembrer cette fusion charnelle millénaire. La prochaine mouture de la Constitution devrait réparer cette absence de vigilance politique et réhabiliter la langue consensuelle de ce pays. En assurant à Tamazight une protection juridique constitutionnelle, nous n’avons fait qu’entamer le processus. Il s’agit maintenant de poursuivre cette démarche nationale et démocratique pour préserver les équilibres historiquement forgés et consolider irréversiblement le ciment de notre jeune nation. Non les questions identitaires ne se sont pas éteintes parce que l’on a décidé de ne plus en parler. Leurs retombées sur la société sont telles (chacun y allant de ses « mythes fondateurs ») qu’on ne peut faire la politique de l’autruche indéfiniment.
La darija et son rôle moteur dans l’islamisation du Maghreb
Notre histoire de l’antiquité a été écrite essentiellement par la colonisation française. C’est à partir de ce filtre de lecture que nos jeunes générations kabylophones, plus particulièrement se sentent remontées et révoltées. Un travail de restitution – selon des sources croisées – reste à faire. De ce point de vue, la question linguistique est centrale. En effet comment les messagers de l’Islam auraient-ils pu convaincre massivement nos ancêtres si ces derniers avaient été exclusivement berbérophones ? Ils ont réussi parce que la population parlait majoritairement la langue punique. Cette dernière a été introduite par les Phéniciens, certes, mais la civilisation carthaginoise en a fait la langue commune, en sus des parlers locaux qui se sont maintenus (à l’instar de Massinissa). C’est donc bien par le biais de la darija de l’époque que la communication a pu être établie et que l’islamisation du Maghreb a réussi en un temps record. La darija antique a servi de béquille à la langue du Coran. Et c’est en binôme qu’elles ont réussi à ancrer la civilisation arabo-musulmane. Qui donc aurait intérêt à les séparer aujourd’hui ?
La langue punique nous paraît bien lointaine pourtant plus de 60 % de notre darija est du punique qui a évolué au contact de l’arabe (Cf. A. Elimam « Le maghribi alias ed-darija » – Éditions Frantz Fanon). Au musée du Bardo à Carthage, les vestiges de la langue sont en lettres puniques et traduites en arabe et en français. Ce qui donne l’impression d’une certaine distance. Or en transcrivant les lettres puniques en lettres arabes, le décor change complètement de ton. Dans notre ouvrage, nous avons mis au point un lexique de près de 500 entrées puniques collectées, à partir de corpus authentiques. Leur pérennisation à hauteur de 60 % (au moins) peut être constatée par tout le monde. En conséquence, sans la présence de la darija, les diffuseurs de l’Islam auraient eu bien du mal : l’islamisation a réussi grâce à une savante collaboration des deux langues. Nous sommes, aujourd’hui, les héritiers de cette histoire et nous devons préserver cet équilibre entre les deux langues : l’une pour le fiqh, la science et le lien avec le monde arabe ; l’autre pour continuer de faire vivre la culture nationale et la singularité de notre algérianité. Cette dernière est une synthèse d’histoire qui nous a conduit jusqu’au 1er novembre 1954 et ensuite à la nation algérienne avec son drapeau et sa souveraineté mondialement reconnue.
La reconnaissance de la darija (que je nomme maghribi, personnellement), créerait un équilibre avec la langue tamazight car les locuteurs auront, enfin, l’impression qu’ils existent et qu’ils ont leur mot à dire. Dans le contexte de discrimination linguistique que nous vivons de nos jours, on handicape la langue de la maison – sur l’espace administratif et politique notamment. Mais ce faisant, on réduit notre potentiel de civisme et d’accès à une citoyenneté moderne. Avant un passé assez récent, le problème ne s’était jamais posé en termes de confrontations entre l’arabe et la darija, mais plutôt en termes de complémentarité et de coopération. Comme cela avait commencé à se faire dès le VII ème siècle. Depuis, la langue arabe a pris une dimension universelle pendant que la darija a produit une littérature extraordinaire en zajel, malhûn et autres styles. De nos jours, cette littérature a mille ans et nos institutions la déprécient encore. Il y a là une réparation historique à engager pour notre salut commun. Une Algérie où toutes les langues maternelles seront reconnues et défendues par la loi est une nation qui prendra appui sur ses propres citoyens enfin réconciliés avec leur vrai passé. Les langues naturelles sont le seul réservoir à mémoires sociales que l’humanité ait pu concevoir.
La darija, une langue distincte mais solidaire de l’arabe[2]
Imaginons-nous dans une salle d’attente d’un grand hôpital. Les patients sont appelés au fur et à mesure, mais au lieu de les appeler par leurs noms, on les appelle par des traits de leur physionomie : «le petit borgne ; salle de consultation 22 », « le rouquin aux yeux malins, salle de consultation 12 », etc. Cela paraîtrait incongru, n’est-ce pas? Je ressens le même effet lorsque je lis le mot «dialecte» attribué à la darija ou maghribi. Alors, arrêtons-nous un instant pour examiner la chose.
En effet, pour quelles raisons ce terme est-il si galvaudé en Algérie (et dans tout le Maghreb)? En fait, il nous vient de l’arabe où le mot « lahdja » renvoie au parler d’une région ou d’un lieu-dit. Partant de cette définition, la notion de «langue » renvoie forcément à une entité «supra-communautaire », donc sans ancrage social et culturel. Or il se trouve, précisément, que c’est le cas avec la langue arabe. D’abord langue du Message coranique: elle se prolonge en langue franche lors de l’essor de la civilisation arabo-musulmane et de manière contemporaine, en langue de l’administration étatique du monde arabe. Comment pourrait-elle à la fois porter les particularismes locaux (lieux par excellence de la production de la culture) et les représentations religieuses et idéologiques transnationales ? C’est de cette dualité de perspectives que s’est imposée, historiquement, la nécessité de faire vivre la culture locale dans les parlers locaux et recourir à la langue franche commune, l’arabe, pour entretenir notre appartenance à la Oumma. D’ailleurs l’étymologie de « darija » renvoie à ce qui « roule », aux «mots les plus usuels », bref, la « langue du peuple » (3ammiya). Il ressort clairement que la darija est la langue usuelle alors que l’arabe n’est, par nature historique, ni usuelle, ni populaire. D’ailleurs elle n’a jamais cédé à la tentation de se laisser soumettre aux volontés des dirigeants politiques pas plus qu’elle n’a pu devenir langue native de quiconque (depuis 14 siècles !). Soulignons, par ailleurs, que tout être humain appartient nécessairement à une communauté sociale et émerge en tant que personne avec le parler local. Ainsi pourrions-nous définir la personne humaine. Ceci est d’autant plus important à rappeler qu’il s’agit d’un ordre des choses qui dépasse la volonté des hommes, puisque c’est le sort réservé à toute notre espèce depuis la nuit des temps.
Mais en quittant les représentations de la langue arabe pour s’offrir une traduction simpliste, on a traduit « darija » par « dialecte » ; alors que « vernaculaire » aurait été bien plus pertinent. Or le mot «dialecte», surtout en français, renvoie à toutes ces langues régionales que l’Abbée Grégoire, 1793, a balayées en les qualifiant de « dialectes et patois ». Et voilà que nous héritons, avec le mot « dialecte», de représentations qui n’ont rien à voir avec notre histoire culturelle. C’est à partir d’une telle représentation que des notions comme «lughat al-chari3 » (« langue de la rue »), «lughat al-souq » (« langue du marché »), etc. ont été accolées à la darija. Nos compatriotes (maghrébins) qui colportent de telles représentations ne se rendent même pas compte du ridicule de leurs assertions. A quoi opposent-ils donc la « langue de la rue », à la langue des boulevards ? à la langue des foyers ? à la langue des nantis ? à la langue des dominants ? Et quand bien même : ce sont les humains qui donnent vie aux langues et non pas l’inverse. Car une langue sans ancrage social et culturel n’est plus une langue, au sens linguistique du terme. L’autre lacune qui se révèle dans ces discours de haine de soi, c’est celle des « registres linguistiques », comme les appellent les linguistes. En effet les usages et les contextes sociologiques nous imposent des « façons de parler » qui ne sont pas les mêmes.
– Avec un camarade de classe, de quartier ou de régiment, on peut se permettre un « registre relâché » avec des mots en verlan, en argot, des mots crus et des expressions libérées de toute censure. (جيب كروستك و كلاكصوني عليهم – «Ramène ta bagnole et klaxonne-leur ! »).
– Avec nos parents et nos enseignants, etc. nous recourons à un registre soigné qui est le registre standard, en réalité. (أدخول التاريخ باخطاوي امرتبة .أخطاوي على أخطاوي متعاقبة. أخطاوي غالبة و أخطاوي مغلوبة وأخطاوي مغصوبة بالحربة – « Fais une entré dans l’histoire à pas cadencés, à pas ordonnés, à pas de vainqueurs et à pas de vaincus, à pas brimés par la baïonnette ». Réplique d’un personnage de « El Huma Maskuna » du dramaturge algérien, Sid Ahmed Sahla).
– Enfin lorsque nous écrivons de la poésie ou que nous rédigeons un document destiné à un public savant, nous empruntons un registre soutenu (avec un choix de mots rares et scientifiques, par exemple). (عزوني يا ملاح في رايس البنات * سكنت تحت اللحود ناري مقديا يــاخي أنـــا ضرير بيــــا ما بيــا * قلبي سافر مع الضامر حيزيــا – Consolez-moi, nobles amis, la reine des Belles repose sous les pierres du tombeau, un feu ardent me dévore, je suis à bout. Ô sort cruel ! Mon cœur a suivi la svelte Hyzia – extrait du poème du XIX è., Said et Hiziya).
Par conséquent la « lughat al-chari3 » relève tout simplement du registre relâché – ce n’est pas une « langue en soi ». Mais Dieu merci, le maghribi permet d’accéder à des registres bien plus élaborés ; voire précieux (Cf. le malHûn, par exemple). Tout parler possède ces trois registres linguistiques – sauf l’arabe. En effet, nous le rappelions plus haut, l’arabe a d’abord été la langue du Message coranique (sa norme a été élaborée après l’avènement du Coran et non pas avant !) avant d’être adaptée aux besoins de la civilisation arabo-musulmane en tant que langue franche. Elle ne connaît qu’un registre, le juridico-religieux.
Les sciences du langage nous enseignent qu’une « langue » désigne les caractéristiques des parler de personnes composant une communauté. En ce sens, elle est une étiquette identifiant un groupe, une tribu, une région, un pays. Cela étant dit, les éléments caractérisant une langue (mots, accents, etc.) sont des produits émanant de personnes humaines et non pas de leurs langues. Une langue n’a pas de réalité tangible, sinon à travers la parole des humains. C’est parce que j’entends parler une personne que je déduis qu’elle appartient à telle ou telle langue. Les langues ne parlent, ni ne font quoi que ce soit. Pour nous résumer, disons qu’une langue, c’est avant tout une étiquette attribuée à un groupe d’humains partageant un code similaire pour leur communication verbale. Quant à la notion de « dialecte », elle n’a aucune pertinence en linguistique. Tous les parlers naturels sont obligatoirement structurés- ils obéissent à des règles que l’organe du langage met en place – car les locuteurs parviennent spontanément à se comprendre. Sinon il n’y aurait pas de compréhension du tout. En fait, dame Nature a tout prévu!
Outre les différences morphologiques, ce qui distingue les langues entre elles, ce sont les statuts politiques et juridiques qui leur sont accolés. Ce qui est un critère extralinguistique, on en conviendra. Mais une langue qui est minorée par l’institution (comme c’est le cas du maghribi), comment peut-elle continuer à jouer son rôle de binôme de la langue arabe transnationale ? Comment peut-on continuer à la fois de participer à la vie de la Oumma et d’assurer la circulation des produits de la culture locale? Rappelons que c’est de cette répartition des fonctions que l’arabe et le maghribi ont permis de faire naître une culture maghrébine qui se distingue de la culture du Machrek par maints traits. En réduisant ce binôme linguistique à une hégémonie arabophone, on prend le risque de briser la béquille sur laquelle la cohésion socioculturelle et cultuelle maghrébine a historiquement reposé.
C’est bien parce que l’arabe ne s’identifie qu’à un registre unique que le recours aux langues populaires (lughat el-3ammiya) a constitué un des éléments précieux de stabilisation de la société arabo-musulmane. Où que vous irez, vous rencontrerez ce phénomène de dualité linguistique : en Arabie (najdi ou Hidjazi + arabe), en Palestine/Jordanie (falistini+ arabe), en Irak (Iraki + arabe), en Tunisie (tounsi + arabe), au Maroc (moghrabi + arabe), en Egypte (masri + arabe), en Algérie (darija + arabe), etc. L’opposition [langue locale vs. langue arabe] n’a pas d’assises, ni historiques, ni sociologiques. C’est une création d’abord de l’occupant turc, chez nous, puis du système colonialiste français. D’ailleurs les langues locales du monde arabe (qoraychi, falistini, masri, moghrabi, etc.) existaient bel et bien avant l’avènement du Coran et l’émergence de la norme arabe (VII è. siècle). Partant de là, comment expliquer que ces langues soient soudainement devenues des « dialectes » de l’arabe ? Non ce sont toutes des langues sémitiques (au même titre que l’arabe) – à la rigueur pourrions-nous dire qu’elles appartiennent à la famille des langues sémitiques. Le fait est que les maîtres à penser arabes ont assimilé le mot « sémitique » à celui de «3arabiy » et de ce fait, il est courant de lire des auteurs vous raconter que le syriaque ou le punique sont des langues « arabes », en lieu et place de « sémitiques ». En cela ils nous induisent en erreur. Clairement. Notre langue majoritaire, la darija/maghribi est une évolution du punique au contact de l’arabe ; elle n’est pas de l’arabe. En effet plus de 60% de notre langue (mots, verbes, expressions, etc.) étaient déjà disponibles dans la langue punique (entre 800 av. JC. et le VI è. siècle de notre ère). Par contre, au même titre que l’arabe, elle fait partie des langues sémitiques.
On voit bien que la protection de la darija – en consacrant cette dernière dans la nouvelle mouture de la constitution – devient un acte de survie d’une culture dont nous sommes devenus les fossoyeurs, malgré nous. Accepter d’admettre la darija en tant que langue à part entière sera un grand pas de franchi vers la reconstruction de notre cohésion socioculturelle, vers notre algérianité.
Le temps où même l’Association des Oulémas défendait la darija[3]
Dans une des publications de l’association de Ibn Badis, Al-Baṣaʾir (21 février 1936), un article en première page se fait remarquer par son titre : « Nous avons atteint un stade où nous craignons pour la darija ! ». Son auteur est un illustre expert en science coranique de même qu’un Cheikh reconnu et respecté, Aboulabbas Ahmed Benalhachimi (originaire de Aïn Madhi).
Cet appel du cœur édité il y a 84 ans, témoigne de l’angoisse des lettrés de l’époque face à la détérioration de la langue maternelle par manque de vigilance de ses locuteurs – mais aussi parce que son enseignement avait été délaissé.
Sachant que l’association des oulémas est réputée pour ses positions en faveur exclusive de l’arabe classique, il paraîtrait étrange qu’elle permette une tribune pour la défense de la langue 3amiya. L’auteur tire cela au clair en ces termes : « Quant à la langue du peuple (al-lugha al-3āmiya), il semblerait qu’elle ne bénéficie pas des égards de l’Association et n’entre pas dans le cadre de ses travaux. Cependant, celui qui étudie méthodiquement la question constate le lien complet et global qui unit la langue fosḥa et le dialectal.» Partant du lien entre les deux langues, il explique les évolutions naturelles que vivent les langues : « Rien de nouveau ni d’étonnant, puisque nous avons montré que, dans l’histoire des langues, il est arrivé au latin la même chose qu’à l’arabe aujourd’hui.». En somme le latin reste langue de la science pendant que les langues dites « latin vulgaire » sont devenues les langues de communication comme c’est le cas de l’italien, de l’espagnol ou du français. Pour l’auteur, donc, la notion de 3amiya est à rapprocher de sa signification profonde de «fédératrice », donc langue qui fédère et qui rapproche les locuteurs, tandis que la langue fosha reste une langue pour les sciences. Cette dualité linguistique avec une répartition claire des fonctions de communication sociale permet de souligner l’indispensable solidarité entre les deux langues. L’une ne peut exclure l’autre, en somme. Ce commentaire, l’auteur le pousse plus loin pour souligner la nécessité de la 3amiya pour la survie de la ûmma : « Comment nier alors que la langue dialectale est l’une des plus grandes manifestations de la vie de la ûmma, indispensable instrument commun pour l’intercompréhension entre les catégories courantes ? ». Ce commentaire, pousse l’auteur à une autre audace en cela qu’il considère que les hommes de sciences auraient intérêt à s’enrichir de la langue 3amiya car, dit-il : « ce serait le moyen le plus sûr et le plus profitable pour attirer la masse vers la science et préparer les esprits à accepter la preuve (al-ḥujja), d’autant qu’elle n’impose ni frais ni fatigue à ceux qui l’étudient ».
La richesse de la langue 3amiya constitue un atout central dans la plaidoirie en faveur de la darija. En effet, très tôt l’auteur dit avoir ressenti « ce que cache la langue dialectale (al-lugha al-darija) sous le couvercle de son caractère commun (3amiya-ti-ha)) comme abondante richesse linguistique.» Ceci donne l’occasion de pointer un autre argument de taille, celui du patrimoine linguistique (al-usul al-lughawiya). C’est de l’émerveillement de la richesse de vocabulaire dans les différents parlers ruraux et citadins qu’il conclut que cela doit être préservé et transmis aux générations montantes. Cela le conduit à s’inquiéter de ces situations où la vie sociale est limitée à des clichés linguistiques (où on s’essaie à parler en fosha) alors que la vie abonde de sujets de tous ordres qui intéressent tout le monde. Mais les limites que l’on s’oblige dans l’usage de la langue fait que l’on s’abstient de parler. Ceci est regrettable à plus d’un titre d’autant plus que cela pousse les gens à des « mélanges de langues » dont le résultat n’est ni la leur, ni la langue des étrangers. Conscient du rôle déterminant de la langue maternelle, il ajoute : « C’est ainsi que nous avons vu qu’outre l’hypocrite en islam (munafiq fīl-islam), il en existe un autre, l’hypocrite dans la parole (munafiq fī l-kalam). C’est ce qui m’a amené à faire appel à vous, les jeunes, pour que vous accordiez à la langue de vos ancêtres et de votre communauté (ûmma) une grande part de vos efforts et votre intérêt sincère. »
Voilà des recommandations vieilles de plus de 80 ans que j’aimerais partager avec mes compatriotes contemporains pour que la nouvelle constitution enregistre ce patrimoine et s’engage à le préserver et le développer. En fin de compte, si l’arabisation a été contre-productive, c’est parce qu’elle s’est opposée à la 3amiya au lieu de prendre appui sur elle. On nous l’a dit 26 ans avant l’indépendance nationale. Aucune équipe au pouvoir n’a pris cela au sérieux et la planification linguistique a été confiée à des idéologues plutôt qu’à des hommes de sciences amoureux de leur algérianité en même temps que solidaires de la ûmma.
[1] Parus dans le Quotidien d’Oran du 22/06/2021
[2] Paru dans Le Soir d’Algérie du 09/97/2020.
[3] Paru dans L’Expression du 17/08/2020
CHAPITRE 3. Identité et histoire : les raisons d’un mal-être
L’errance identitaire: entre leurre linguistique et histoire fantasmée[1]
La pierre et la terre – en tant que vestiges et miroirs de notre histoire – nous enseignent que l‘antique langue punique continue de vivre sous l’habit de la darija contemporaine et que le libyque se perpétue sous appellation contemporaine de tamazight. Or avec l’émergence des États nationaux du Maghreb, autant tamazight réussit à devenir langue nationale et officielle, autant la darija est reléguée au rang de sous-langue, pâle copie «créolisée» de l’arabe. Le paradoxe est que cet état de fait est motivé par une référence à «l’histoire», une histoire complètement détournée et falsifiée. Il suffirait, pour se fixer, de s’en informer auprès d’historiens reconnus et légitimés par leurs pairs. Ma propre relecture de sources diverses – c’est-à-dire non exclusivement françaises – m’amène à constater un véritable détournement-réécriture de notre histoire antique, plus particulièrement. Or, nous savons depuis l’effondrement du bloc socialiste d’Europe centrale (en particulier) que la falsification de l’histoire agit en boomerang dévastateur. Dans cette Algérie venant à peine au monde en sa qualité de nation souveraine, des signes inquiétants de haine, de xénophobie et de rejets ethno-centrés se manifestent ça et là. Pourtant, après bien des siècles de dominations exogènes, l’Algérie est apparue, en 1962, en tant qu’entité pleine et solidaire. Moins d’un demi siècle plus tard, la voilà rongée de l’intérieur par les effets d’une politique linguistique à la fois autoritaire, approximative et dictée par des pressions idéologico-politiques. Or «qui veut aller loin ménage sa monture», dit-on. Raison de plus pour réviser – tous ensemble – l’histoire tout court, et, par conséquent, l’histoire linguistique de cette contrée qui nous abrite. Les grandes lignes d’une politique linguistique nationale et démocratique pourront alors sereinement s’imposer à tous, dans l’intérêt de la préservation de nos langues maternelles multi-millénaires (punique et libyque).
En s’ouvrant à l’histoire, autour du VII e siècle av. J.C., l’Afrique du nord voit émerger, parmi tant d’autres, une langue dont l’hégémonie s’imposera d’elle-même 15 siècles durant, au moins: le punique. Cette variété du phénicien prend place au milieu d’une panoplie de langues. L’antiquité nord-africaine témoigne, en effet, de la présence de variétés dites libyques, mais aussi de l’hébreu, du copte, du syriaque, du grec, du persan, et bien d’autres langues (africaines, notamment) dont on a perdu trace.
Le succès de la langue punique au Maghreb tient à la puissance civilisationnelle de Carthage mais aussi à son appartenance à l’aire sémitique; ce qui la rapproche des langues autochtones qui lui préexistaient. Les formes d’organisation et de communication avec les populations locales ont, longtemps, permis à Carthage de gagner respect et loyauté. Les autochtones vivaient en relative autonomie; certains se laissèrent intégrer par la langue et les valeurs carthaginoises, d’autres, à l’instar du Royaume numide, auraient préféré conserver leur autonomie, dit-on. Cependant, l’expérience souveraine numide qui n’aura duré qu’un siècle et demi, témoigne d’un recours à la langue punique comme langue officielle et pour frapper monnaie. Ce qui nous invite à largement réviser les mythes que l’on nous sert de nos jours.
Après l’effondrement de Carthage (en -146) et durant la domination de l’empire romain, le profil linguistique a bien peu bougé. Il est largement attesté que le punique a bel et bien survécu en Afrique du nord – plus à la campagne que dans les centres urbains, selon Saint Augustin. Et cela quasiment jusqu’à l’arrivée des Arabes, après le VIIe siècle ap. J.C. Ni la langue romaine, ni le grec ne sont parvenus à évincer le punique qui, notons-le, tout de même, a troqué son alphabet pour l’écrit latin; ce que confirment aussi bien les traces écrites de cette période que la latinisation des noms de personnes et de lieux. Les parlers libyques, pour leur part, se sont maintenus dans les territoires où des tribus aux alliances anciennes ont su préserver leur autonomie, sans jamais s’imposer aux locuteurs des autres régions. Il faudrait d’ailleurs s’interroger sur la rareté des traces écrites (en tifinagh, notamment) pour témoigner d’une couverture conséquente alors que l’humanité entière s’empare de l’écrit – quels qu’en aient pu être les alphabets – plus de deux mille ans avant l’ère numide.
A l’arrivée des diffuseurs de l’Islam, il y a bel et bien eu des poches de résistance, essentiellement byzantines, incluant le court épisode de la Kahina, mais elles n’ont pas fait long feu. Il s’est même produit une osmose que nul historien contemporain n’a pu élucider: une sorte de fraternisation entre les populations locales et les «Arabes». Or ceci s’explique prosaïquement par le fait que les populations parlaient/comprenaient, majoritairement, une langue sémitique proche de l’arabe: le punique. C’est cela qui a permis d’atteindre une réelle intercompréhension entre les nouveaux arrivants et les autochtones; ce qui aurait été impossible si la population avait été exclusivement libycophone. Un autre facteur aura contribué au succès de cette conversion religieuse massive: le monothéisme était déjà bien ancré dans la culture dominante. De fait, il n’y a pas eu “arabisation”, mais islamisation; contrairement à des mythes savamment élaborés et distillés dans l’épistémè colonial.
Les punicophones (ou les punicisés) ainsi que les libycophones ont manifestement préservé leurs langues maternelles tout en intégrant l’arabe à des fonctions tout à fait nouvelles: les rites religieux islamiques, le fiqh (droit islamique), la grammaire de la langue du Coran (naħw), les récitations du Coran et l’administration islamique introduite par les nouveaux conquérants. Les Arabes étant bien peu nombreux pour provoquer une colonisation par la population, ont passé le relai aux autochtones qui se sont rapidement ralliés à la cause religieuse et ont grossi les rangs des prédicateurs. C’est ainsi que des tribus autochtones se sont vu confier la représentation politique du califat – sans aucune modification notable sur le plan des usages linguistiques au quotidien.
Il est un fait qui échappe fâcheusement aux contemporains: la langue arabe n’a dû (et ne doit encore) sa survie qu’à sa cohabitation avec le néo-punique et le libyque (ou berbère). En effet, hormis les fonctions administratives et cultuelles, ce sont les langues maternelles qui prenaient en charge l’essentiel des besoins de communication sociale et de vie culturelle. En moins de trois siècles, le néo-punique se refait une santé linguistique en comblant ses lacunes grâce aux apports (sémitiques, donc «absorbables») de l’arabe et s’impose en tant que lingua franca avec ses spécificités lexicales, grammaticales et phonétiques. De nombreux vestiges littéraires des premiers siècles de l’ancrage arabo-musulman en témoignent (adab ez-zajel et malhûn étant les plus connus). La préservation de la cohabitation des langues autochtones avec l’arabe était déterminante pour le succès des nouveaux conquérants; en effet, comment expliquer et/ou traduire les messages si cela n’avait pas été le cas? Ce qui était valable pour le néo-punique, l’était également pour le libyque – cela continue, y compris de nos jours.
Le processus d’individuation linguistique du néo-punique au contact de l’arabe arrive à maturité autour du IX-X e siècle pour laisser émerger cette «’amiya» qu’il serait plus juste d’appeler maghribi – plutôt que « darija ». Les variétés libyques, pour leur part, continuèrent de survivre dans leurs territoires d’origine tout en intégrant – à l’instar de toutes les langues naturelles – des «maghribismes» et des «arabismes» à leurs idiomes. En somme cela fait bien 10 siècles que la forme «maghribie» du punique s’impose au Maghreb: d’abord par une adaptation de l’alphabet arabe – al-khatt al-maghribi –, puis par une production littéraire extraordinaire (adab ez-zajel, al-muwashahat, al-malhûn, etc.), et devient la langue hégémonique des Maghrébins. D’ailleurs, s’il y avait eu arabisation, c’est l’arabe façiH que nous parlerions aujourd’hui. Or c’est bien le maghribi (al-’miyya) qui est la langue qui a fait consensus. Cela aussi est un fait d’histoire culturelle maghrébine dont l’occultation (ou la distorsion) est source de bien des confusions et raidissements idéologiques.
Avec l’avènement de la nation algérienne en tant qu’État souverain, une quatrième langue (en plus du maghribi, du berbère et de l’arabe) vient enrichir le répertoire linguistique maghrébin: le français, langue du dernier colonisateur. La méconnaissance de notre histoire et le poids de celle que nous auront vendue les idéologues du colonat français conduisent la politique linguistique nationale vers des écueils aux blessures profondes. Après l’indépendance, ni le maghribi (darija), ni le berbère ne sont retenus. Le français et l’arabe se partagent le territoire linguistique officiel. Il aura fallu attendre 2002 pour que les variétés maternelles libyques soient reconnues en tant qu’entité dite «tamazight» – étiquette qui renvoie non pas une langue maternelle, mais à une construction bureaucratique qui fait fonds sur un symbole bien ancré. Quant à la langue consensuelle et dont la littérature millénaire (et écrite!) est pourtant disponible et accessible, elle se voit refuser tout statut par les défenseurs du temple arabo-islamique. Mais aussi par une frange importante des berbérophones qui craignent une «contamination linguistique» alors qu’avec l’arabe classique, une sorte de sérénité s’est installée. Les luttes pour la démocratie l’ignorent totalement. Et les gens expriment leur «haine de soi» linguistique … en langue maghribie, essentiellement («hadi guè3 mâchi loughâ»)! Le système scolaire a inculqué aux enfants ce sentiment de dévalorisation linguistique et, hormis tamazight et l’arabe classique, la défense de la darija s’exprime en fuite en avant «politiquement correcte». Quant au nombre d’experts linguistes spontanés, il est probablement l’un des plus élevés au monde…
Il est vrai que la référence à l’histoire est revendiquée ça et là. Mais il s’agit d’une histoire révisée et fantasmée. Le maghribi, langue effectivement consensuelle du Maghreb, est présenté injustement comme de l’arabe souillé alors que c’est une langue sémitique au même titre que l’arabe et tant d’autres. Elle a ses codes grammaticaux, son vocabulaire et ses lettres de noblesse. La reconnaissance de tamazight est à la fois une victoire symbolique et un champ d’illusions pour les locuteurs berbérophones, car la langue tamazight n’est la langue maternelle de personne. De fait nous assistons à ce que nous pourrions appeler un «leurre linguistique» qui sert de substitution aux langues berbères maternelles et historiques. Là est un autre drame dont les retombées pourraient être encore plus terribles. D’ores et déjà, c’est cet anachronisme qui alimente le ferment de révolte des jeunes gens kabylophones qui se voient frustrés de taqbaylit au nom d’un symbole linguistique. Ce leurre apparaît au grand jour dès que l’on voit des kabylophones désolés de ne pas comprendre le journal télévisé en «tamazight» ou cette littérature de laboratoire qui fleurit depuis quelques années et destinée à d’hypothétiques lecteurs. Un linguiste national (Pr. A. Dourari) parle d’une «novolangue» en rupture avec la réalité des échanges berbérophones natifs, au quotidien. Cette frustration est pour l’instant refoulée au bénéfice d’une idéologie pan-berbériste – mais rien ne changera sa nature de bombe à retardement. Le dépassement viendra de la reprise en main, par les locuteurs natifs, de leurs langues maternelles et du rejet du leurre qu’on leur fait miroiter. Les processus de planification linguistique reposent sur bien d’autres méthodologies (éprouvées) que celles qui ont cours actuellement et qui, devant l’échec massif de l’aventure (Cf. le vidage des classes de tamazight en Kabylie même), évoquent une généralisation/obligation du leurre. On le voit, les deux aires linguistiques maternelles souffrent d’un même type de rapport diglossique. Le maghribi, pour sa part, n’attend qu’une simple reconnaissance officielle.
Toute société humaine se pérennise et préserve sa cohérence en puisant dans sa culture. La reconnaissance institutionnelle des deux langues maternelles aura un double effet: 1. Elle rétablira un équilibre entre locuteurs des deux grandes aires linguistiques maternelles; 2. Elle assurera à la citoyenneté, en cours de gestation, de s’établir et de s’épanouir. C’est en renouant avec notre histoire effective que nous nous inscrirons à nouveau dans ce sillage multimillénaire qui nous a forgés jusqu’à nous permettre aujourd’hui, en locuteurs libres, de nous interroger sérieusement sur notre avenir en tant que société humaine.
Algérianité et replis identitaires[2]
Nous avons trop souffert, dans un passé récent, de censure (et d’autocensure, certes) dès lors que la question des langues maternelles était soulevée. Les compatriotes amazighophones en ont payé le plus lourd tribu, incontestablement. Mais il nous a été donné de constater que ces questions ont longtemps été prises en otage par les politiques en mal de mobilisation. Que ce soit pour attiser les foules autour d’objectifs qui débordent du « linguistique » (Cf. programmes des partis politiques de la Kabylie) ou bien pour réduire à néant la revendication linguistique (Cf. la mouvance islamiste organisée et, dans une certaine mesure, les arabo-nationalistes). Or, récemment, l’émergence du Hirak sur la scène de l’histoire aura brisé bien des peurs et des interdits pour permettre une expression enfin libérée. La question identitaire – ou appelée comme telle par ses promoteurs – étant d’un intérêt général, elle nous oblige toutes et tous.
Le fait que la revendication linguistique berbérophone aboutisse après tant de luttes et de souffrances est, en soi, un acquis démocratique historique, pour notre pays. Il faudra donc en préserver l’aboutissement car cela contribue à tisser la toile de la démocratie linguistique. En effet, le principe universel de cette dernière est que les locuteurs ayant une langue maternelle de la nation puissent accéder à leur langue et que la communauté nationale pourvoit à son développement et à sa protection. Les langues maternelles en Algérie, ce sont quelques langues berbères bien identifiées, mais également la darija (principe défendu par le MCB, dès la première heure). Une partie du chemin a été parcourue, il reste à faire émerger la darija. L’atteinte de la démocratie linguistique, on le voit, est encore à venir.
A cette vision, somme toute moderne et démocratique, s’opposent des forces politiques qui disent « craindre » pour l’unité de la nation. Or l’unité nationale a commencé à se cimenter autour du mouvement national puis de la lutte pour l’indépendance nationale ; non pas en arabe classique, mais bel et bien dans les langues maternelles de la nation. Par conséquent, c’est même l’inverse qui s’est produit !
On nous oppose que la darija est une sous-langue qui pervertit la pureté de l’arabe. Or la darija est une évolution du punique, qui elle-même était la langue de la civilisation carthaginoise. Par conséquent, elle était la langue la plus parlée du Maghreb (y compris dans la Numidie de Massinissa), 1000 ans avant l’arrivée des Arabes. Comment peut-elle avoir été présente avant la langue-mère ? Par conséquent c’est l’inverse qui s’est produit !
On dit également que la multiplicité des langues et plus particulièrement la darija constitue une menace pour la langue du Coran dont nous sommes les protecteurs, devant Dieu. Or c’est grâce à la darija, plus particulièrement, que l’Islam a été introduit au Maghreb. Arabe et darija ont marché main dans la main des siècles durant. Par conséquent, c’est l’inverse qui s’est produit !
On le voit, ce qui concourt à rassembler ce sont les langues maternelles (langues berbères + darija). Ce qui concourt à diviser, c’est leur négation ou bien leur mise en confrontation.
Nous disions plus haut que le principe de démocratie linguistique vise à assurer aux langues maternelles protection institutionnelle et moyens de développement. Or certains voudraient, en imposant la généralisation de tamazight, tourner le dos à ce principe universel et, dans la foulée, opposer amazighophones à darijaphones. Les mêmes semblent offusqués dès qu’une opinion divergente leur est opposée. Attention, à vouloir « sacraliser » une question aussi sensible que la langue maternelle, on touche à l’essence même de la personne humaine. Il faudra donc raison garder.
On nous dit que nous sommes « Arabes » par la religion et « Amazighes » par l’histoire. Or la religion n’a pas de langue -70% des musulmans sur terre ne sont pas arabophones. Quant à l’hégémonie attribuée à l’identité amazighe, elle apparaît toute relative dans l’histoire effective du Maghreb. Il y avait des populations multilingues (appelées par les Romains « berbères » parce qu’elles ne parlaient pas latin) qu’il serait plus rigoureux d’appeler les autochtones. C’est la descendance de ces autochtones maghrébins qui a réussi à pérenniser la darija (anciennement « punique ») et les variétés berbères (anciennement « libyque »). Riches des apports des différentes civilisations qui ont occupé le Maghreb, nous sommes, de nos jours, la synthèse d’un passé que l’on ne peut travestir sans risques. De fait, les variétés berbères ainsi que la darija sont les vraies langues maternelles qui ont rendu possible cette culture commune qui constitue le socle de notre identité contemporaine: l’algérianité.
Il serait temps que le terrain de nos confrontations politiques et idéologiques se déplace vers cette source revivifiante qu’est l’algérianité. C’est autour de cet axe que l’avenir pourra s’écrire de toutes nos mains, sans toutefois renier les contradictions socio-économiques qui en sont le moteur. C’est autour de cet axe qu’il nous faudra lire l’histoire (et non pas les fictions même si elles émanent des puissants) et garantir la pérennisation de notre socle national.
Le déni de la darija et ce qu’il nous en coûte[3]
Au moment où l’on s’apprête à enrichir la Constitution, il faudrait revenir (encore et encore) sur ce qui n’est que le début des retombées du sentiment de haine de sa propre langue.
Certains de nos compatriotes croient (ou feignent de croire) que s’opposer à la darija est le seul moyen de protéger la langue arabe. Or, outre le fait qu’ils conçoivent la langue du Coran comme une « faiblesse » qu’il faut protéger, ils oublient que c’est grâce à la darija – déjà présente depuis plus de 1500 ans – que la langue arabe a pu s’installer et se maintenir chez nous. Et oui, l’ancêtre de la darija est la langue de Carthage, le punique. Et le punique est proche de l’arabe. Les deux langues ont donc coopéré – chacune occupant des fonctions propres : la vie cultuelle (fiqh, sunna, l’exégèse coranique, la gestion administrative) pour l’une ; et la vie socioculturelle, y compris la littérature « populaire », ayant laissé de nombreuses traces écrites, pour l’autre.
C’est la proximité linguistique des deux langues qui aura permis à l’arabe de se propager. La visée de l’ouverture islamique n’était pas d’imposer une hégémonie linguistique, mais de faire accepter le Message. D’ailleurs, comment cela s’est-il passé là où il n’y avait pas de proximité linguistique comme en Iran ou en Turquie et dans 70% des pays musulmans ? Le persan n’a pas été absorbé par l’arabe, pas plus que le turc ou toutes ces langues d’Indonésie, de Chine et d’ailleurs. La darija est donc bien loin d’être une menace pour l’arabe d’autant plus qu’elle en aura été le mentor. En faisant barrage à la langue maternelle majoritaire de ce pays, on scie la branche sur laquelle on est assis. Pense-t-on réellement bien faire ? Et pourtant en rejetant la langue sœur de l’arabe (et du berbère) on ne fait que retarder l’émergence d’une intelligentsia algérienne; voire maghrébine, sur la scène internationale.
La politique linguistique algérienne a surtout misé sur l’arabisation en ayant laissé sur le carreau les langues maternelles – ces choix de principe avaient été retenus avant même l’avènement de l’indépendance. La doctrine en l’espèce partait du principe que nous étions tous arabophones avant la colonisation française et que cette dernière a dénaturé notre langue avec pour objectif de la réduire au statut de « dialecte », voire de « patois », sans valeur et sans profondeur. Une telle option faisait écho au mot d’ordre de l’association des Oulémas de Ben Badis de se réapproprier « notre » langue. C’est ainsi que notre jeune État a mis en œuvre tous les moyens (idéologiques, politiques, humains, matériels, financiers, administratifs, éditoriaux, juridiques, etc.) au service de ce retour à «notre» langue. Or, après plus d’un demi-siècle d’efforts soutenus, qu’avons-nous à récolter ?
– Nous avons l’un des systèmes éducatifs les plus mauvais au monde (Cf. classements PISA) ;
– Les élèves entrent dans le système scolaire en parlant la langue que leur cerveau capte, tout naturellement, dès la naissance, ils en ressortent quasi illettrés – et pas seulement en arabe!
– Les études du secondaire développent la mémoire et affaiblissent l’intelligence critique.
– Le passage à l’entonnoir du supérieur voit une infime minorité atteindre la post-graduation.
– Dans leur masse, les citoyens illettrés en arabe ou non berbérophones sont mis en marge de l’intégration civique (médias, administration, etc.).
La relève tant espérée par nos anciens est lourdement contrariée tant sur un plan quantitatif que qualitatif. A cette sécheresse culturelle et linguistique vient se greffer l’hémorragie endémique des métiers: pénuries de maçons (sérieux), de plombiers, de réparateurs spécialisés, de techniciens capables de maîtriser le moindre outil, d’ingénieurs fonctionnels à la sortie de leurs parcours universitaires, etc.
En somme un bilan bien contrariant. Mais attention : ceci n’est pas dû à l’arabisation (bien ou mal planifiée), non. Ceci est dû à la mise à l’écart de la langue que Dieu nous prépare à acquérir à notre naissance. Il s’agit bien d’un don du Ciel : les nourrissons viennent à la parole comme ils apprennent à se mettre debout puis à marcher. Ceci est inscrit dans les gènes de tout humain. Lorsque la politique vient contrarier la nature (ce qui se passe avec les langues maternelles peut se passer avec les lits d’oueds ou de rivières), la nature le lui rend … et a toujours le dernier mot. Cela ne mérite-t-il pas d’y méditer et faire acte d’humilité devant la puissance de la nature ?
Tamazight est sauvé – sur le plan institutionnel, s’entend. Il reste à réhabiliter la darija (maghribi) ne serait-ce que pour ces quelques raisons principales :
1. L’histoire atteste qu’à côté du berbère, une grande langue de civilisation s’était enracinée à partir de la Grande Carthage punique : cette langue est ce que nous appelons communément la darija et que je préfère appeler le maghribi ;
2. Les habitants d’Afrique du nord ont facilité la pénétration de l’Islam grâce au fait qu’une bonne partie de la population parlait/comprenait une langue de la même famille que celle de l’arabe : le punique;
3. La darija (maghribi) a été l’instrument de l’adhésion massive et globalement pacifique à l’islam ;
4. La darija et la fosħa ont donc toujours cohabité et c’est l’expérience d’Al Andalus qui témoigne le mieux de leur complémentarité – poésie jazel et malħûn, notamment;
5. Les différents pouvoirs arabo-musulmans qui se sont succédés (des Omeyyades aux Ottomans) ont largement tiré avantage de ce bilinguisme de fait – (y compris le bilinguisme berbère –arabe) ;
6. La relance du punique en tant que darija s’opère vers le VIII è siècle avec la maghribinisation de l’alphabet arab (khatt al-maghribi) – que Al Andalus adoptera avec fierté;
7. On tend, par complexe, à réduire la darija à ces parlers citadins où le mélange de plusieurs codes fait « tendance », occultant que le maghribi repose sur un patrimoine littéraire de plus de 1000 ans ;
8. Exclue de l’espace institutionnel, la darija résiste malgré tout (théâtre, chanson, poésie, cinéma, TV, publicité, ħirak, etc.) et maintient (encore) la cohérence sociale à l’écart du chaos culturel et psychologique;
9. On sait qu’un peuple que l’on détourne de sa propre langue maternelle est appelé à verser dans le déni permanent et dans la violence ;
10. Le déni du don de la Nature qu’est celui de la langue maternelle développe des pathologies (dont le « mal-être » algérien, la ħarga, les drogues et bien d’autres formes de schizophrénie).
Dans la foulée des ouvertures civilisationnelles que le ħirak a permis, Il est opportun de mettre à jour cette politique linguistique, sur la base des connaissances historiques auxquelles nous pouvons accéder de nos jours. De fait, la darija a une histoire millénaire que nous ne pourrons pas occulter sous prétexte que ce fait d’histoire nous échappait. Comment oser rejeter une présence linguistique de 3000 ans que rien ni personne ne pourra effacer car elle est langue maternelle d’une majorité écrasante de la population du Maghreb ? Notre génération et celles à venir ne pourront pas prétendre ne pas savoir que la fosħa et la darija ont cohabité intelligemment durant des siècles ; ce qui a permis de développer les deux cultures : la nationale et celle de la Oumma. La culture nationale est matérialisée par un patrimoine textuel (qacidates, poésie, contes, narrations, documents scientifiques et pratiques, etc.) qui s’accumule depuis plus de 1000 ans. Quant à la culture de la Oumma, elle est plus particulièrement prise en charge par des instances internationales (Ligue des Etats Arabes, etc.). Or, pour des raisons probablement liées au «mal-être» algérien et au sentiment de « haine de soi », les choix politiques qui se sont succédé avaient plus à cœur de maintenir la culture de la Oumma que de promouvoir les langues et culture nationales, jugées – par certains – non dignes de considération. Or l’organe vital de la Oumma, ce sont les nations qui lui donnent consistance.
Ne serait-il pas temps de renverser la vapeur ? Ne serait-il pas temps de réaliser l’ampleur de ces lacunes et de rectifier le tir ? Comment préparer l’accès à la citoyenneté tout en rejetant et en marginalisant les langues maternelles ? Ne serait-il pas temps de fêter nos 60 ans d’existence avec un espace linguistique et culturel réhabilité et dont la revitalisation en profondeur est actée?
Il revient à chacun d’entre nous de prendre ses responsabilités pour qu’à partir des débats sur la révision de la Constitution nous parvenions à assurer à la darija (maghribi) sa protection juridique. Ainsi planterons-nous, dans la nouvelle version de la Constitution, le principe cardinal de la démocratie linguistique, seul garant de la pérennisation de la protection de toutes les langues maternelles de la nation.
Darija : est-ce le moment ?[4]
En toute bonne foi, quelques amis se posent la question de savoir si soulever la question du statut de la darija, dans le contexte actuel, est bien opportun. Oubliant, par là, que nous sommes en cours de débats sur la révision de la Constitution et qu’une question sociétale comme le statut des langues maternelles doit y trouver consécration. Une fois que la Constitution aura entériné la protection de toutes les langues maternelles sans exclusion, alors la sérénité constitutionnelle deviendra un repère pour affiner et mettre en œuvre la politique linguistique nationale mise à jour. Ceci pour la conjoncture.
Par ailleurs, les questions linguistiques sont bien loin de se réduire à un habillage opportuniste. Les sciences contemporaines nous apprennent que le langage est avant tout un organe dont le centre computationnel est le cerveau et dont la partie motrice est à la fois dans notre appareil vocal et dans le corps (mains, bras, mimiques, etc.). Et lorsque cette faculté humaine dont la Nature nous gratifie est inhibée, c’est toute une série de dysfonctionnements neurophysiologiques que l’on déclenche. Les réactions de ces dysfonctionnements sont diverses, mais disons que leurs symptômes les plus manifestes sont les explosions de violence quasi spontanées, le repli sur soi et/ou la fuite en avant religieuse ou activiste. Si l’on regroupe ces trois symptômes, nous décrivons la source du mal-être algérien.
A l’âge de cinq-six ans, l’enfant est devenu, selon les psycholinguistes, un locuteur « expert » dans sa langue de naissance. Il est capable de tout comprendre autour de lui, il est sensible à l’humour et aux jeux de mots, il a une faculté narrative qui surprend ses propres parents, il est capable de mentir et d’inventer des situations aussi plausibles que possible. Tous les parents peuvent témoigner de cela. Dès son entrée à l’école, ce locuteur de la langue « A » se voit exposé à la langue scolaire, « B » ; une langue bien distincte de celle qui l’a porté jusqu’ici. On lui apprend alors que la langue « A » est une sous-langue, une langue « B » souillée. Que cette langue ne mérite même pas le titre de « langue » et que tous ceux qui l’utilisent sont des gens illettrés, incultes ; voire mécréants. Quand vous avez six ans et que vous vous trouvez confrontés à un tel laminage de votre personnalité en cours de gestation, il ne vous reste plus que deux issues : (1) vous raccrocher à la survalorisation de « B » parce qu’elle serait celle du Coran et (2) recourir à votre capacité de mémorisation pour vous mettre en règle avec les évaluations scolaires. Pendant ce temps-là, les zones du cerveau qui gèrent la langue de naissance sont privées de leurs routines. C’est de ce manque à gagner que toute une série de mécanismes cognitifs se verront détourner de leurs vocations : le sens de l’observation ; l’orientation dans l’espace ; les opérations logiques telles que la déduction, l’inférence ou l’analogie ; l’esprit critique constructif ; sans parler des manques à gagner quant à notre histoire et à notre patrimoine littéraire et culturel.
Une fois adulte, il a bien conscience qu’il a arraché un «papier-diplôme » à l’issue d’une scolarité faite de «copier-coller » et de restitutions mémorielles. Pour se frayer un chemin en vue de son intégration socio-économique, il va se forger à des pratiques confortées par un consensus implicite d’opacité et de népotisme en place et lieu de droits civiques. Là encore, il lui faudra composer, faire des alliances contre-nature : en somme étouffer ce qu’il lui reste des valeurs laissées en legs par les générations antérieures. Une société de «passe-droit» ou mieux d’anomie, s’impose aux individus devenus si transparents qu’ils peuvent apparaître à tout moment: modernistes, racistes, conservateurs, tolérants, humanistes, ethno-puristes. Cet anachronisme caractérise le Maghrébin contemporain – avec des degrés divers selon l’éducation de base et les milieux familiaux.
Le citoyen se cherche, se met en quête de valeurs, essaie de faire de son mieux, d’offrir le meilleur à ses enfants … mais voilà : une chape de plomb pèse sur ses espérances. L’attrait de la fuite est toujours là, la projection d’une vie ailleurs, d’une vie meilleure – au risque de sa propre vie dans une embarcation de fortune – : nous sommes travaillés de l’intérieur. Rien ne nous satisfait ; ni les efforts des pouvoirs publics, ni ceux de nos concitoyens. Tout est suspect et matière à vigilance. Le temps a fabriqué une sorte de schizophrénie culturelle. Plus personne ne vous dira qu’il/elle croit en ce pays. Un désenchantement massif s’est emparé de la société bien que l’envie de s’en sortir est là, à portée de main.
Qu’est-ce que la darija a avoir avec tout ça, me diriez-vous? Et bien je défends la thèse que c’est son statut qui est une des sources principales de ce mal-être. Et qu’en pansant cette blessure à la fois symbolique et neuro- comportementale, on parviendra à remonter la pente. Un des traitements les plus sûrs de la remontée vers l’espérance et l’épanouissement de la personne humaine c’est la protection de sa langue maternelle.
Si la société arabe a réussi à maintenir un équilibre entre Ûmma et culture nationale, c’est bien parce que la dualité linguistique faite de l’arabe et de la langue maternelle a été préservée de manière à laisser à la langue native (Najdi ou Hidjazi, Falestini, Iraqi, Tounsi, Moghrabi, Masri et bien d’autres encore) sa place dans la société. C’est même ce réflexe qui a permis aux générations antérieures de générer des valeurs humaines et culturelles que nous regrettons de jour en jour. Le début de la rupture a été le rejet de la darija et sa minoration (la réduire à un registre de langue unique et ridicule alors qu’elle est productrice d’une littérature de 1000 ans, littérature qui a émerveillé un Ibn Khaldûn, notamment). Nous disposons donc du remède «naturel » au recentrage des individus et à la récupération de valeurs (cultuelles et culturelles) que nous avons cessé de reproduire. La solution de base est somme toute bien simple : réhabiliter la darija.
Que perdrait-on à redonner à la dualité linguistique qui nous a caractérisés près de 9 siècles, la place qui lui revient? Quel risque prendrait-on à protéger la darija au même titre que tamazight ? Quel risque prendrait-on à essayer d’introduire les langues natives dans le système éducatif alors que toutes les autres solutions se sont avérées inadéquates ? Quel risque prendrait-on à voir nos enfants aimer l’école parce qu’elle les valorise (enfin) et qu’elle valorise leurs ascendants en même temps ?
Ce sont ces préoccupations et leur remède à la fois simple et à portée de main que je défends et que je souhaiterais voir consacrés dans la prochaine mouture de la Constitution.
Chapitre 4 – L’algérianité linguistique: une gestation entravée
Question linguistique et algérianité[1]
Je présente deux textes destinés à la presse (1989 et 2001) qui témoignent de ce long combat mené en faveur de la reconnaissance de nos langues maternelles et plus particulièrement ce que j’avais commencé à appeler “l’arabe algérien” avant de le nommer “maghrébin” et aujourd’hui le “maghribi”. Ces articles reflètent aussi l’évolution de la réflexion sur ces questions au fil du temps, des lectures et des savoirs nouveaux (neurosciences cognitives, plus particulièrement). Enfin le concept de « algérianité linguistique” faisait ses premiers pas sous ma plume. Relisant ces textes aujourd’hui, je procéderais bien à quelques reformulations, mais je maintiens l’essentiel des points de vue défendus … même si mes compagnons de lutte, qui alors défendaient les langues maternelles amazighes ont tourné le dos à cette revendication pour soutenir l’émergence d’une hypostase, en l’espèce de “tamazight”.
La permanence du problème linguistique en Algérie, peu ou prou reconnu par tous, paraît d’autant plus paradoxale que le processus d’arabisation ne fait qu’en souligner la dimension. Si, çà et là, on attribue aux difficultés rencontrées des origines de nature éthique, pédagogique, didactique ou socio-culturelle, le processus d’arabisation en cours ne traduit, en réalité, qu’un conflit identitaire. Notre pratique de chercheur en linguistique nous a conduit, à plusieurs reprises, à prendre position sur le cas algérien. Nous nous risquons à réitérer notre point de vue au moment où la question linguistique tend à devenir le lieu de démarcation entre les partisans d’une algérianité dignement assumée, d’une part; et les partisans de solutions supra-nationales et autoritaires, d’autre part. Nous pensons effectivement que les voies de solution du problème linguistique en Algérie n’apparaîtront clairement qu’à partir du moment où l’Algérien réapprendra :
1). à assumer son identité (historiquement forgée) algérienne parce que maghrébine;
2). à prendre en charge sa réalité linguistique et culturelle.
Or, reconnaître cela c’est se donner le moyen d’ accéder à la seule voie de solution possible du problème linguistique.
1. Langage et identité
De quelque bord politique qu’ils soient, les défenseurs du processus d’arabisation actuel (dans sa forme et/ou dans son fond) semblent s’accorder sur une chose au moins: la question linguistique doit, à leurs yeux, forger un être nouveau, un Algérien autre([2]). Il s’agirait, en somme, de troquer une algérianité historiquement élaborée pour se fondre dans un espace culturel et linguistique idéel et illusoire. Essayons de tirer cela au clair. Dans l’un de ses articles , A. Cheriet ([3]) remarque , au passage, que « la société arabe » rencontre ce « problème qui demeure et qui risque de demeurer posé encore longtemps, parce qu’il n’a cessé de se poser depuis environ 14 siècles, c’est la dualité linguistique de la société arabe » (p.31). Notre auteur, en reconnaissant la difficulté de la tâche, pointe le doigt sur la vraie question, la seule qui nécessiterait que l’on s’y attarde un peu. En effet :
– Comment se fait-il que les pays majoritairement arabophones (la « société arabe ») ont toujours eu à faire face à cette « dualité linguistique », c’est-à-dire au conflit (symbolique, tout au moins) entre « dialectes » locaux et langue arabe ?
– Par ailleurs, si après 14 siècles d’efforts, aucun pays arabe n’a réussi à solutionner ce problème, par quel moyen l’Algérie y parviendra-t-elle ?
– Et s’il s’agissait tout simplement d’une résistance, multi-séculaire, traduisant un mécanisme naturel de préservation de l’identité ([4]) ?
Cependant, et pour y voir plus clair, il faudrait éviter de jeter le bébé avec l’eau du bain. Reconnaissons, en effet, que parler de « société arabe », revient à voiler la réalité nationale; pire, à exclure le processus historique qui l’a portée. Dans ces cas-là, il ne peut s’agir que de nation; en l’occurrence de la nation algérienne. C’est par ses spécificités géographiques et socio-culturelles qu’elle a pris, historiquement, ses traits distinctifs. Le dernier mouvement populaire qui lui a permis de s’imposer sur l’arène internationale contemporaine a été un mouvement authentiquement et exclusivement national. Que les revendications nationales aient pu être formulées, avec l’islamité pour repère identitaire principal, cela tout le monde en convient. Cependant évitons de confondre arabité et islamité. Si la population du monde musulman compte près de 880 millions d’âmes, la part des arabophones est d’environ 140 millions. Soit 16 % de musulmans arabophones ([5]). Que dire alors des 672 millions (84 %)de musulmans non arabophones ? Que la langue liturgique et de dévotion, en l’occurrence la fuçħa, soit reconnue dans sa vocation sacrée et dans son statut religieux, cela personne ne peut décemment le nier. Tout musulman, arabophone ou non, l’utilise pour invoquer Dieu; c’est même cela qui a permis la préservation de son caractère exceptionnel, à l’abri de l’intervention humaine([6]). Ne pouvant s’agir, de la manière la plus rigoureuse, de la fuçħa, quelle est donc cette langue qui fait l’objet de l’arabisation en Algérie ? En réalité, cet arabe que l’on enseigne et que la presse (écrite ou audiovisuelle) diffuse n’est autre qu’une « langue de laboratoire » forgée par des politiques et des intellectuels en mal d’utopie. Il est vrai qu’elle semble ( par son stock lexical et sa grammaire) très proche de la fuçħa, mais ce qui la rend à la fois attrayante et insaisissable, c’est justement sa nature « bricolée »([7]). L’utopie qui en a motivé le moulage, à sa façon, répond à ce mythe de langue commune supranationale que l’on retrouve ailleurs, dans ces centaines de langues artificielles dont l’espéranto est la plus connue. Sans rentrer dans le détail historique de son émergence notons tout de même qu’elle n’a pas le statut de langue naturelle ([8]) . Soulignons, de surcroît, qu’il n’existepas un seul locuteur dans le monde arabophone qui puisse se prévaloir de cette langue-là commelangue maternelle . Cela ne donne-t-il pas matière à réflexion ? En effet seule une langue naturelle peut être (voire devenir) une langue maternelle et l’arabe moderne supranational n’est pas une langue (en toute rigueur scientifique) naturelle. Là réside le fond du problème, il n’est pas ailleurs. Ceux qui soutiennent que la généralisation de l’arabe moderne supranational n’est qu’une simple affaire technique (modalités d’enseignement, choix de supports, etc.) font fausse route. Car le langage est le moyen par lequel tout humain accède à sa socialisation ; en cela que cette faculté (de représentation symbolique du monde objectif) est le propre de l’espèce. C’est là que se structurent et se forgent et l’inconscient et la personnalité. Or c’est dans et par la langue maternelle que s’objective cette faculté langagière du petit de l’homme. Là est le berceau de l’identité culturelle et sociale. Nier cela c’est nier l’humain.
Le mythe de « l’homme nouveau » justifierait-il de sacrifier des générations de locuteurs ?
2. Dialectes et Langue de culture
La « dualité linguistique »([9]) propre aux pays majoritairement arabophones est souvent posée dans les termes suivants: il y aurait, d’une part, la ou les langue(s) populaire(s)([10]) – essentiellement orales – ; d’autre part, la ou les langue(s) de « Culture » et de « Science » – essentiellement écrites -. La question posée est de savoir si ce que l’on appelle un « dialecte » est, à l’instar d’une « vraie » langue, en mesure de dire la science et la littérature. Mais avant d’y répondre il faudrait déjà se mettre d’accord sur ce que recouvre la notion de « dialecte ». Pour tous les linguistes, un dialecte est une langue à partir du moment où il répond à un système (phonologique, syntaxique et sémantique) linguistique. Ce qui le distingue d’une « langue » à part entière, c’est seulement son statut idéologique et politique. En somme une langue n’est qu’un dialecte qui accède au pouvoir. Dès qu’un tel dialecte devient un moyen de diffusion et de contrôle aux mains d’un pouvoir politique, il se voit auréolé de l’attribut « langue » et comme par enchantement devient « capable » de tout exprimer; même la science!
Reconnaître, avec la communauté scientifique internationale, que toute langue n’est qu’un dialecte auréolé de pouvoir, c’est rompre avec le préjugé prétendant qu’un dialecte serait démuni de moyens de représentation des connaissances. A moins de nous faire la preuve que le « dialectal » ne remplit pas les critères de langue (le pouvoir en moins!) … Cela étant, que parlent-ils donc chez eux nos linguistes spontanés ? Comment s’adressent-ils à leurs enfants, à leurs épouses, à leurs parents ? La dualité linguistique, ils la vivent au même titre que monsieur-tout-le-monde. Ils en souffrent (à des degrés divers, certes) de la même manière. Cependant le point de vue visant à minorer le dialectal semble être motivé par une préoccupation d’une nature autre. Le problème, refoulé, il faut le dire, c’est la question du berbère.
2.1. La question du berbère
En effet, reconnaître officiellement le « dialectal » , c’est s’obliger à reconnaître officiellement la langue berbère dans ses variétés algériennes. Or, comment nier la présence multiséculaire ([11]) des variétés berbères ? N’est-ce pas cette même réalité qui a nourri, au fil des siècles, l’identité algérienne ? Qui pourrait sérieusement nier que la diffusion de l’Islam en Afrique du Nord et en Espagne doit son succès aux berbérophones qui, jadis peuplaient ce pays ? La lutte de libération nationale n’a-t-elle pas trouvé chez les Algériens berbérophones autant de partisans (et en proportion, peut-être même plus) que chez leurs compatriotes arabophones ? Cependant, lorsque les arguments historiques ou scientifiques se révèlent stériles, on se met à invoquer la menace que ferait peser sur la nation un certain « nationalisme kabyle » et « anti-arabe » de surcroît ! Qu’il existe des manifestations vivantes et parfois violentes de mouvements de contestation d’un ordre linguistique contraignant et « glottophagique », cela n’est que juste retour des choses. Mais que peuvent représenter (en proportion) quelques groupuscules nationalistes chauvins dans la masse des berbérophones de langue maternelle ? Pas grand chose, il faut le dire. Par ailleurs, la revendication linguistique berbérophone est l’une des revendications nationales et démocratiques des plus saines. Elle exprime le désir de recouvrer une identité brimée et minorée (particulièrement par le colonialisme français) que seul l’accès à l’indépendance nationale pouvait permettre. Ce qui serait la moindre des choses, n’est-ce pas ? Dès lors qu’est-ce qui est à craindre? L’élan patriotique que pourrait libérer le recouvrement total et sans exclusive d’une part importante de l’identité algérienne ? La démocratisation de la vie publique, scientifique et technique ? La revalorisation de l’individu longtemps sous le joug de puissances coloniales diverses? Que craignent donc les défenseurs de solutions linguistiques supranationales? Ne craindraient-ils pas, en réalité, leur propre image, celle que leur renvoie l’Algérie indépendante?
3. Profil linguistique de l’Algérie indépendante
Nous nous retrouvons par conséquent avec un profil linguistique algérien relativement simple (en comparaison avec des pays comme la Suisse, les Etats-Unis d’Amérique, l’Inde ou la plupart des pays africains).
Les langues du « terroir » sont de deux types:
– Une aire linguistique à base arabe, majoritaire et relativement cohérente;
– Une aire linguistique à base berbère aux concentrations géographiques marquées.
A côté de ces langues du terroir, existent:
– La fuçħa comme langue liturgique et de dévotion;
– L’arabe moderne (ou « classique » ou « littéraire ») remplissant le statut idéologique de langue officielle d’Etat ([12]) ;
– Le français, en perte de vitesse dans la société, mais dont le statut de langue internationale de communication est maintenu ([13]) (médias, administration, enseignement supérieur, monde des affaires, etc.).
– Ajoutons à ces langues, celles ([14]) dont l’influence médiatique, même symbolique, existe bel et bien: l’égyptien contemporain, le libanais, l’espagnol, l’italien.
Cela nous offre, essentiellement, un regroupement selon deux types :
1. Les langues de la nation et de communication effective que sont l’arabe algérien et le berbère algérien ;
2. Les langues supra-nationales et superstructurelles que sont la fuçħa, l’arabe moderne et le français .
Ramené à sa juste proportion, le profil linguistique de l’Algérie indépendante semble bien moins problématique qu’on n’a voulu le suggérer. Ainsi l’opposition, « francisants – arabisants » se dévoile pour ce qu’elle est: une diversion politique sans fondement stratégique sérieux. Cette opposition surfaite et subtilement entretenue (par les uns et par les autres) n’a qu’un seul mérite – si tant est qu’on puisse parler de mérite – celui d’écarter les langues de la nation. Rien n’empêche de s’approprier toutes les langues de communication internationale que l’on veut. La question est de savoir si les langues du terroir vont, oui ou non, être le support naturel favorisant l’accès aux connaissances.
4. Statut des langues en présence
4.1. La fuçħa
On a vu plus haut qu’il ne serait ni convenable, ni sérieux de réduire la fuçħa à l’arabe moderne. La langue de la liturgie et de la dévotion, même si son influence est effective dans le parler de tous les jours, a un statut à part. Et cela est valable pour les 84 % de musulmans non arabophones que compte la terre. L’aspect révélé et sacré du Coran inflige aux croyants un respect total de la sainte écriture dont l’espace référentiel se limite au texte lui-même. C’est cela qui l’a préservée historiquement. C’est cela, c.à.d. son autonomie, qui la préservera à l’avenir. Imposer cette même langue comme langue d’Etat reviendrait à s’octroyer le droit, à terme, de modifier et d’adapter ladite langue à la gestion des affaires publiques. Pas un musulman ne s’aventurerait dans un tel dessein.
4.2. L’arabe moderne
Langue d’enseignement et de communication commune aux pays arabes/arabophones, elle est superstructurelle par essence. Son aspect de « déjà vu » suscite l’illusion « qu’on la connaît déjà », « que notre dialecte en est très proche », etc. Son appropriation par les locuteurs reste cependant très problématique.
En effet, les adultes, dans leur majorité, ont beaucoup de mal à la « réapprendre ». Son utilisation publique se limite, généralement, à de l’écrit sous forme orale. La redondance des clichés dont elle regorge en fait une langue de bois parfaite.
Quant aux enfants, scolarisés dans cette langue dès le primaire, ils continuent de ne l’utiliser qu’en classe en faisant appel, essentiellement à la récitation, au réflexe du »parcoeurisme » . De plus en plus nombreux sont les observateurs qui soulignent les effets déstructurants du statut de cette même langue sur le langage des enfants. Il ne se trouve plus un seul didacticien des langues qui ne reconnaisse, de nos jours, que l’apprentissage d’une langue est affaire :
1. de passage de la langue maternelle à la langue cible,
2. d’inscription de l’individu en sujet de la langue.
Faire abstraction de la langue maternelle est, en matière de didactique des langues, une grave illusion d’optique qui ne peut aboutir qu’à un échec certain. Le bilan de toutes les méthodes structurales (inspirées de la même erreur méthodologique) aboutit au même constat de défaillance. Quant à l’inscription de l’individu en sujet de la langue, elle implique non seulement que la langue maternelle ne soit point refoulée, mais, de surcroît, qu’elle soit le support à toute appréhension du réel. C’est parce que l’individu est être de désir qu’il est être de langage. Oublier cela, c’est nier la spécificité de l’humain. Notons avec satisfaction que bien des aspects de ces remarques trouvent un écho dans le remarquable travail d’analyse critique dû à la plume de M. Greffou ([15]) ; pour ne citer qu’un travail récent.
Il faut néanmoins souligner que ce sont ses propres effets d’illusion qui octroient à cette langue un statut fétiche. Elle est effectivement à la fois proche de la fuçħa et du « dialectal » et de plus elle est utilisée, comme langue de « culture », dans tout le monde arabe/arabophone ! Se confondant, pour le commun des mortels, avec la langue sacrée, elle se voit défendue par ceux-là même qui la vivent conflictuellement comme un mirage. Paraissant à la fois proche et distante du « dialectal », elle provoque chez les dialectophones un sentiment de culpabilisation se réalisant sous la forme de l’auto-odi (de haine de soi-même)[16]. Le discours mystificateur ne se prive, d’ailleurs pas, d’entretenir et de perpétuer la confusion. Elle est, par nature, la langue de l’écrit (avec tout ce que la notion d’écrit peut connoter chez un musulman), donc la langue de la science, par définition; C.Q.F.D. Or ce problème, qui se pose sans solution depuis près de 14 siècles – ainsi que le reconnaît A. Cheriet -, par quel type d’enchantement va-t-il être dépassé ? Par l’émergence d’un « homme nouveau »: sans mémoire, sans histoire, sans biographie individuelle, sans inconscient, sans désir, sans territoire ? Nous nous situons là en amont d’un processus décrit par ailleurs (18) comme une névrose diglossique.
4.3. Le berbère
Notons que la notion de « berbère » renvoie à un générique qui englobe toute l’aire linguistique berbérophone. Il serait donc plus rigoureux de parler de kabyle, de chaoui, etc. Le travail le plus important effectué en domaine berbérophone a porté, essentiellement, sur le kabyle. Nous renvoyons le lecteur aux travaux de S. Chaker et plus particulièrement à son ouvrage cité infra. Le kabyle, pour nous limiter à cette seule langue, est un véhiculaire dont la cohérence de système (linguistique) ne fait aucun doute. Ses quelques variations phonologiques ou lexicales ne le privent nullement de la systématicité constitutive de toute langue. Langue de culture et de communication sociale quotidienne, il demeure l’un des vestiges les plus vivants de notre identité culturelle. Cependant, son statut de langue minorée l’expose à deux types de risques:
1. Mythifié et fétichisé par ses partisans, il devient l’objet de diverses manipulations dites de réaménagement (ou de planification) linguistique. Or sans le consensus des locuteurs natifs, de telles entreprises se voient vouées à l’échec. Que l’on songe au statut actuel de la langue irlandaise dont la planification s’est faite à l’écart des locuteurs !
2. Marginalisé et inquiété par ses détracteurs, il devient l’objet d’une hyper-glorification (langue-martyre); ce qui suscite passions et débordements dans les tentatives de sa préservation/conservation.
Il suffirait de le reconnaître pour ce qu’il est, c’est-à-dire une langue à part entière, pour atténuer considérablement les deux risques auxquels il reste exposé. Sa reconnaissance, par le pouvoir politique, en tant que langue officielle créerait une situation nouvelle d’apaisement et de banalisation. Ce qui, du coup, éliminerait toute velléité nationaliste chauvine. Dans un pays comme les Etats-Unis d’Amérique, on n’hésite pas à reconnaître officiellement plusieurs langues par Etat. Cela n’a jamais mis en péril ni le pouvoir ni la cohésion socioculturelle de la société. C’est le cas également de la Suisse, de la Belgique, de la Finlande, de l’Inde, etc. La cohésion d’une société puise sa sève dans ses racines sociales, jamais ailleurs.
Comment être soi-même tout en se diluant dans un autre?
4.4. Le dialectal ou maghrébin
Le véhiculaire à très large diffusion/circulation est ce que l’on appelle le dialectal. Le discours mystificateur le présente comme une « sous-langue », de l’arabe souillé par les attaques incessantes de la colonisation française. Avant 1830, toujours selon le même discours, tout le monde aurait parlé la fuçħa. Il aurait donc suffi de 132 ans de présence française pour déstructurer et les locuteurs et leur langue unique ! Drôle de conception de l’histoire, on en conviendra.
Qu’en est-il, en réalité ? Aussi loin que nous puissions chercher, nous avons toujours retrouvé des documents attestés écrits en « dialectal ». Commençons par quelques exemples à titre d’illustration.
1. Voici quelques extraits d’une lettre([17]) écrite par Ibn Redhuan (mezouar au royaume de Tlemcen, caïd des Beni ‘Amer) au roi d’Espagne Charles Quint le 3 février 1535. Il s’agit d’une démarche diplomatique visant à obtenir l’aide des Espagnols, qui occupaient alors la ville d’Oran, en vue de faire face aux velléités hégémoniques de l’occupant turc, alors à Alger. Nous donnons, ici, une transcription complétée d’une traduction assez proche du mot à mot.
“esa:lta:n mûlay bûɛabdala we:na webni ɛamna
Le roi Mulay Bou Abdallah , moi-même , nos cousins
weHbebna ji:na lhedal bled di: wahren wa
ainsi que nos amis sommes venus dans cette ville d’Oran
Tmaɛna nçi:bû fi: maqamkûm jmi:ɛ ma kanû yçi:bû
espérant trouver auprès de votre altesse tout ce que trouvaient
elwayli:n jedi: weɛami: wbe:be:na: maçabû fikûm
nos ancêtres. Mon grand-père, mon oncle et notre père n’ont rencontré auprès de votre altesse
ila elɛna: walmûtaɛawin wa jmiɛ maHabû sabu: fikûm (…)
qu’aide et solidarité. Tout ce qu’ils désiraient, ils l’ont trouvé à vos côtés (…)
wa ma: ji:na: lehna: ila teHt Harmku:m
Et si nous sommes venus vers vous, ce n’est que sous votre autorité.
wakdek qbel ɛli:na: essiyid Dûn el hûnshû di qortu:ba:
C’est ainsi que le sieur Don Alonso de Cordoue nous a accordé son attention
wme: wera:na: ila: lXi:r wa wɛedelna:
et ne nous a témoigné que de bonté. Il nous a offert
jehdû wme:lu: men jihet maqamkûm (…)
sa puissance et sa fortune de la part de votre altesse (…)
Habi:na men maqamkûm tmi:reln:a beljehd wataɛa:win
Nous souhaiterions que votre altesse nous soutienne en force et en solidarité
waXten jûhdkum qa:wi: (…)
d’autant plus que vous êtes puissants (…)
naɛTiw alaɛra:b ma:lna: bash yensHû fi: Xademetkûm wbesh
Nous donnerons aux (tribus) arabes notre fortune pour qu’ils soient solidaires de vos serviteurs et pour
nemnû: fihum yaɛTiwna: elmarahin wnenzlu: fi: wahra:n (…)
que nous puissions leur faire confiance, nous leur demanderons des gages et nous nous installerons à Oran (…)
Htejna: rabɛa miya: ew Xemsa: miya: edi: rajel liHaraketna:
Nous aurons besoin de 400 ou 500 hommes pour notre garde.
2. Un premier extrait d’une poésie de Bna-Msayeb (mort en 1768 à Tlemcen) suivi de sa traduction telle que nous la propose M. Belhalfaoui ([18]):
Me:l Hbi:bi: me:lû ke:n mɛaya ke:n
Me:l Hbi:bi: me:lû ya: ne:si: ghoDbe:n
Me:l Hbi:bi: me:lû li: mûda nerje:lû
Sheweqni: fi: Xiye:lû weqharni: taɛye:n
ɛadabni: bejme:lû Xadɛa ɛla:l ime:n
Traduction:
Ma bien-aimée, qu’est-ce qu’elle a,
Hier encore elle était là, ma bien-aimée.
Alors qu’a-t-elle donc à bouder comme ça ?
Oh ! Que se passe-t-il donc ? Hier seulement, elle m’a quitté,
Et c’est comme une éternité.
Elle me prive de sa beauté et me torture,
Elle me trahit au moment où je m’y attends le moins.
Un second extrait d’une chanson attestée au moins au XVIè siècle. Nous le ferons suivre de sa traduction telle que nous la propose M. Belhalfaoui (o.p. cit):
Dir elɛaqa:r ya: sa:qi: wesqi:ni:
We ejli: elgiya:r beshra:b weHyi:ni:
Fi danha:r zarni: Diya° ɛayni:
Zarni: ghze:li: wjles qbe:li: kama: elqamar yaDwi:
Ma: Hla: eshra:bɛan Xeddi men nehwa
Traduction:
Le doux nectar … sers le-nous, ami;
Assez de broyer du noir … redonne-moi la vie
Donne-moi à boire … ainsi qu’à ma bien-aimée
Puisque ce soir vient la lumière de mes yeux.
Ma gazelle est venue … elle s’est assise en face de moi,
Brillante comme un astre … Oh! que le vin est doux !
Joue contre joue … avec celle que j’aime
Ainsi qu’on peut le constater, ces textes, qu’ils soient du XVIè ou du XVIIIè siècle, sont écrits en langue maghrébine. Il s’agirait, en quelque sorte, de ce que les uns appellent le « dialectal » et les autres, le « populaire ». Langue de la diplomatie de la poésie, de la littérature, le maghrébin (il faut bien l’appeler par son nom !) était largement utilisé bien avant la colonisation française. Comment donc expliquer cela si ce n’est par le processus quasi-universel d’autonomisation linguistique ? En effet il n’existe aucune langue qui soit « pure », dans le sens où elle n’aurait subi aucune influence (lexicale, syntaxique, phonologique) des autres langues. Supprimons les bases latines et grecques du stock lexical du français et ce dernier n’aura plus rien d’une langue ! Il en va de même pour l’anglais qui est à base de latin, de grec et de saxon ; et de toutes les langues vivantes. Alors, que le maghrébin ait puisé l’essentiel de ses bases dans la langue arabe fuçħa, cela n’est pas pour nous étonner ! Mais ce n’est pas la seule langue qui l’ait marqué de son influence. On pourrait ajouter le berbère, le turc, l’espagnol et évidemment le français. Cela dit, le processus d’autonomie linguistique a ceci de particulier qu’il produit une langue autre. Il favorise l’émergence d’un système linguistique avec sa propre cohérence et sa propre économie. Et le maghrébin répond totalement à ces critères. Que l’on fasse une analyse contrastive sérieuse, et l’on verra se profiler un système linguistique dont la cohérence « n’a rien à envier à l’anglais ou au français » (pour reprendre la réaction jubilatoire qu’a eu un de nos étudiants à la fin d’un de nos cours sur la syntaxe maghrébine, à Tlemcen). Cela étant dit, soulignons, avec force, que, historiquement, le processus d’autonomisation apparaît bien antérieurement au XVIè siècle. Autrement, comment justifier l’existence de la langue maghrébine sous des formes diplomatiques ou littéraires déjà cristallisées vers l’an 1500 ? Quand a-t-il commencé ? Probablement avec la diffusion de l’Islam. Par contre, il nous reste à faire des recherches rigoureuses sur la genèse du processus lui-même. Le maghrébin est déjà au XVIè siècle une langue structurée, à large diffusion (de manière certaine cette diffusion s’étalait de l’actuelle Algérie à l’actuel Maroc ; sa diffusion en Tunisie, probable, ne nous est pas connue) mais dont la stabilisation ainsi que la normalisation ont souffert d’un manque d’autonomie politique. La colonisation française n’a fait qu’exacerber ce besoin de cohésion et d’unité culturelle. C’est ce à quoi répondait cette passion pour une Algérie indépendante : la réconciliation avec soi-même!
L’avenir de l’Algérie se joue, à notre sens, dans la reconnaissance sans aucune sorte de complexe, de la langue maghrébine. Gageons que l’on verrait alors se déployer toutes ces énergies inhibées, sclérosées et refoulées. L’enseignement, dès le primaire ([19]), se ferait alors dans la langue maternelle et offrirait l’arabe classique comme première langue de communication internationale. La langue française trouverait, dans ce cas, la place qui lui revient et pourrait être mise en compétition avec la langue anglaise. Enfin la connaissance de toute langue étrangère contribuera à l’épanouissement des enfants algériens enfin réconciliés avec eux-mêmes.
En guise de conclusion
Au terme de cette esquisse qui s’est voulu à la fois didactique et de bon sens, nous restons persuadé que les clés du dépassement sont dans le retroussement de la fameuse « dualité linguistique ». Il faudrait, par conséquent, se réconcilier avec soi-même avant de prétendre à quelque universalité. L’un ne peut aller sans l’autre. Il faudrait, également, en finir avec les préjugés élevés au rang d’argumentation scientifique. A titre d’exemple, comment admettre que, lorsqu’il s’agit de la langue arabe ou du français ou de l’anglais on insiste sur « la richesse de la langue » qui, en offrant plusieurs synonymes, permet d’ « exprimer toutes les nuances de la pensée ». Alors que la présence de synonymes en « dialectal », c’est-à-dire en maghrébin, se voit aussitôt attribuée à je-ne-sais quels désordre, morcellement et division ?
La reconnaissance officielle du maghrébin et du berbère ne présente aucun risque de déstructuration du tissu socio-politique. Bien au contraire. Ce sont ces mêmes langues qui ont préservé, jusque là, et la cohésion de la société et le sentiment d’appartenance effective à un ensemble unitaire.
Pourquoi produiraient-elles, tout d’un coup, l’effet inverse ?
[1] Algérie Actualité, en décembre 1989
[2] Nous faisons allusion, ici, aux différents articles publiés par Algérie Actualité dans les six derniers mois; et plus particulièrement l’étude proposée par le Docteur en Sciences Sociales, D. Labidi , dans les numéros 1237 et 1238.
[3] Sur la politique de l’enseignement et de l’arabisation, SNED, 1983
[4] Si la question de l’identité est parfois abordée, déplorons qu’elle soit quasi systématiquement fondue dans une « identité arabe » à la fois utopique et méthodologiquement erronée. Le patrimoine arabo-musulman, bel et bien réel, ne saurait faire fi d’une réalité algérienne, elle-même produit d’une histoire spécifique.
[5] Sources: A. Moatassime, « Islam et développement », in Revue Tiers Monde T. 23, N° 92, oct-déc. 1982.
[6] Le travail impressionnant (thèse d’Etat), et malheureusement peu connu, de A. Hadj-Salah: linguistique arabe et linguistique générale, 1979, apporte des informations – toujours contrôlées et attestées – fort éclairantes sur le statut de la fuçħa.
[7] Notons qu’un tel sentiment est souvent exprimé par des enseignants (réellement et sérieusement arabisés) qui constatent une réelle différence de réception entre l’arabe moderne et la fuçħa chez leurs élèves. Sur l’histoire ainsi que l’analyse linguistique de l’arabe moderne, mentionnons , entre autres, V. Monteil :L’arabe moderne, Paris Klincksieck, 1960. Par ailleurs, signalons qu’un groupe de recherche, informel, travaille actuellement à la production d’une étude contrastive entre arabe moderne/fuçħa. Elle fera l’objet d’une publication à venir.
[8] La notion de langue naturelle recouvre le processus socio-historique par lequel une communauté se dote (spontanément et informellement) de moyens symboliques de dire le réel en même temps qu’elle pérennise sa cohérence en favorisant et en élargissant la sphère d’intercompréhension. Elle s’oppose, en cela, aux produits de l’intervention humaine, volontariste, qui ne peut fabriquer que des modèles simulés et réduits d’où toute subjectivité est absolument exclue. Jamais l’inconscient ne se structurera dans une langue non naturelle. C’est cela la marque distinctive de l’espèce.
[9] Ailleurs, dans la littérature sociolinguistique, cette dualité est recouverte par le concept de diglossie. Nous évitons d’y recourir, tant il fait l’objet de critiques, actuellement.
[10] . Notons, en passant seulement, que l’utilisation de l’épithète « populaire » permet d’ opérer une distinction avec son opposé, l’anti populaire.
[11] Selon S. Chaker, elle serait bi-millénaire. Se reporter à son ouvrage : Textes en linguistique berbère, Editions du CNRS, Paris, 1984.
[12] Notons que le discours mystificateur sur la question linguistique joue assez sur l’ambiguïté de la notion de « langue nationale » pour à la fois susciter l’adhésion spontanée tout en référant à autre chose. Il serait plus sain de la désigner par ce qu’elle représente: une langue officielle d’Etat. Une langue nationale n’est pas forcément celle de la nation !
[13] L’attitude des partisans d’une arabisation catégorique reste trouble face à la langue française. Quel type de démon essaient-ils de chasser ? Mais ne dit-on pas que « qui aime bien châtie bien » ?
[14] Il ne faudrait pas sous-estimer l’influence des langues diffusées par les canaux télévisuels. Autrement, comment expliquer qu’un enfant de sept ans, à Oran, puisse appeler une « veste », « baltos » ? Et cela malgré les « efforts » de l’institution scolaire totalement arabisée !
[15] L’école algérienne de Ibn Badis à Pavlov, à paraître aux éditions LAPHOMIC, Alger.
[16] Robert Lafont : « La neurósi diglossia, in Lengas n° 16, 1984.
[17] Sources: C. de la Véronne, Oran et Tlemcen dans la première moitié du XVIè siècle, Ed. Geuthner, Paris, 1983.
[18] La poésie arabe maghrébine d’expression populaire, Ed. F. Maspéro, 198
[19] Notons qu’à plusieurs reprises, des experts de l’UNESCO ont fortement recommandé que l’enseignement se fasse dans la langue maternelle, durant les trois premières années du primaire, au moins. Pour plus de détail renvoyons entre autres, à l’ouvrage: Enseignement et langue maternelle en Afrique occidentale, Ed. Les Presses de l’UNESCO, Paris, 1976.
[1] Paru dans Le Soir d’Algérie du 17/05/2021.
[2] Paru dans L’Expression du 28/09/2020.
[3] Paru dans Le Quotidien du 04/06/2020.
[4] Paru dans L’Expression du 21/7/2021
Brève biographie
Abdou (AbdelJlil) Elimam (en arabe : عبده الإمام), né le 22 octobre 1949 à Oran, et mort le 31 août 2023 en Espagne[1], est un linguiste algérien parmi ceux du courant énonciatif français, qui assument l’héritage de Gustave Guillaume et d’Émile Benveniste. Sur les traces de Antoine Culioli, Henri Adamczewski et de Robert Lafont, il soutient une thèse de doctorat de 3e cycle à l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (en linguistique anglaise) et une thèse de doctorat d’État à Rouen (linguistique générale). Trois phases ont ponctué ses centres d’intérêt : la sociolinguistique du Maghreb et la défense du maghribi ; la didactique des langues secondes (dont le FLE) ; les retombées des sciences cognitives sur la théorie du langage. Actuellement il travaille sur les bases méthodologiques et théoriques d’un rapprochement entre Ray Jackendoff et Noam Chomsky, d’un côté et Antoine Culioli, de l’autre.
Carrière professionnelle
Abdou Elimam est depuis 2002 maître de conférences à l’École nationale polytechnique d’Oran, naguère École normale supérieure d’enseignement technique (ENSET) d’Oran. Il a exercé également les fonctions de directeur du Centre culturel français de Naplouse de 1997 à 2001[2] et a travaillé à l’Institut de culture populaire de Tlemcen. Il a été professeur invité ou chargé de cours à l’Université de Rouen, à l’INALCO et consultant en ingénierie linguistique pour diverses entreprises.
Centres d’intérêt
C’est sa quête du statut de la langue maternelle qui motive Abdou Elimam à s’engager en linguistique. La théorie de l’énonciation initiée par Émile Benveniste et formalisée par Antoine Culioli va le séduire en cela qu’elle prend ancrage dans une théorie de l’acquisition qui permet l’émergence d’un sujet de l’énonciation et conçoit le langage produit comme un événement énonciatif (1981). La sociolinguistique, en tentant de répondre aux questions Qui parle à Qui, de Quoi, Comment, Quand Où et Pourquoi fera intervenir les questions de la norme linguistique, de la diglossie, du bilinguisme et du multilinguisme. Dans une mise en relation dialectique entre Corpus et Statut social (2004), Son engagement en didactique des langues lui permet de formaliser la question du rapport entre langue maternelle et langue autre. C’est dans les thèses de Stephen Pit Corder, Larry Selinker et Stephen Krashen qu’il trouvera des réponses claires sur le rapport entre acquisition et apprentissage (2006(a), 2012). Enfin, les sciences cognitives contemporaines, qui commencent à dévoiler partie des mécanismes de l’activité cérébrale en œuvre dans l’émergence de la langue native. Cependant les retombées des neurosciences invitent à revisiter la théorie linguistique telle qu’elle a prévalu jusqu’ici et Abdou Elimam (20063(b), 2011, 2012), en posant le primat de la question du sens, opère une distinction entre faculté du langage et formes linguistiques d’extériorisation. Se sentant très proches des préoccupations contemporaines de Ray Jackendoff, il envisage de revisiter les thèses de la Grammaire universelle, de la théorie de l’énonciation et de la question du sens à partir d’une vision rafraîchie.
Par ailleurs, au début des années 90, il a activement participé à la conception et au lancement du projet d’économie Alternative et durable « La Caisse de Transactions » en France en collaboration très étroite avec son fondateur Franck Fouqueray. Ses connaissances de linguiste furent déterminantes dans l’application d’un modèle économique équitable et durable.
La question du maghribi
En tentant de jeter la lumière sur la vie langagière du Maghreb pré-islamique, Abdou Elimam découvre que la langue introduite par les Phéniciens en Afrique du Nord, le punique, s’avère langue substrat (à hauteur de 50 % en moyenne) dans les parlers contemporains du Maghreb et de Malte (1997). Ce qui conduit Abdou Elimam à oser un regard renouvelé et critique sur la nature supposée « arabe » des parlers du Maghreb. Son étude assoit la conviction que loin d’être une arabisation (spontanée) de toutes ces contrées, les parlers de Malte et du Maghreb sont des évolutions du punique au contact de l’arabe et du berbère. Rejoignant Charles A. Ferguson et bien des linguistes orientaux, Abdou Elimam nomme maghribi cette identité linguistique polynomique et au substrat punique (1997, 2003).
La didactique des langues secondes
C’est avec Henri Adamczewski que Abdou Elimam apprend à distinguer entre langue acquise par la naissance et langue apprise au terme d’efforts. Cette distinction constituera un repère essentiel dans ses travaux de didactique des langues. En effet la langue maternelle s’acquiert ; elle ne s’apprend pas comme on apprend à coudre ou à fabriquer un objet. Les moyens cognitifs mobilisés dans un cas et dans l’autre ne sont donc pas les mêmes (2006(a)). Tout cela conduit Abdou Elimam à reconsidérer les apprentissages linguistiques – en les distinguant des apprentissages langagiers – et à concevoir la didactique des langues comme une démarche reposant sur trois piliers : la connaissance du fonctionnement des langues humaines ; les mécanismes cognitifs mis en jeu ; les besoins effectifs en langue seconde (2012).
Sciences cognitives et linguistique
Les travaux de Jean-Pierre Changeux, de Antonio Damasio, Michael Tomasello – mais également ceux du linguiste Ray Jackendoff – ont été un facteur d’émulation dans la réflexion contemporaine de Abdou Elimam quant à la théorie du langage. Comment le dispositif natif intervient -il pour mettre en route la mécanique du langage et comment cette dernière s’articule, devraient répondre clairement à la question : qu’est-ce qu’un système linguistique ? Sur la base d’observations irréfutables et méthodologiquement validées, les neurosciences apportent des éclairages qui devraient permettre de mieux (re)définir l’activité langagière et de déterminer le rapport entre sémantique, d’un côté, et morphosyntaxe et phonétique, de l’autre. Abdou Elimam pense pouvoir rapprocher, dans un tel programme, les thèses de Noam Chomsky et Ray Jackendoff de celles de Antoine Culioli.
Bibliographie sélective
1981 Le statut du sujet en linguistique, thèse de doctorat de 3e cycle, Sorbonne Nouvelle
1990 « Algérianité linguistique et démocratie », in Peuples méditerranéens, no 52-53, pp. 103–120.
1997 Le maghribi, langue trois fois millénaire. (ANEP)
2003 Le maghribi, alias “ed-darija”- La langue consensuelle du Maghreb (Dar El-Gharb)
2004 Langues maternelles et citoyenneté. (Dar El-Gharb)
2006(a) L’exception linguistique en didactique. (Dar El-Gharb)
2006(b) « Entre prototypisation et mise en discours : les enjeux du sens », in Mots, Termes et Contextes, dir. D. Blampain, Ph. Thoiron, M. Van Campenhoudt Éditions des archives contemporaines (Paris) / AUF. pp. 109–119.
2009 : « Du punique au maghribi : Trajectoires d’une langue sémito-méditerranéenne », In Synergies Tunisie, no 1, pp. 25–38
2011 : « Le français médium d’enseignement (FME) pour non natifs : entre apports de la recherche linguistique et besoins », in ELA (Études de linguistique appliquée), no 161 (janvier-mars 2011), pp. 79–98
2012 Le français langue seconde d’enseignement – (I.L.V.)
Références